| Dernières réponses | |  A voir sur La Chine qualifie les propos du diplomate américain d'"extrêmement dangereux" A voir sur La Chine qualifie les propos du diplomate américain d'"extrêmement dangereux"
La Chine répond aux propos de Pompeo comparant la Chine à l'Allemagne de l'est, à la veille de la commémoration de la chute du mur.
Si on regarde les murs construits par l'impérialisme et ses valets comme Israël, ou encore ceux destinés à contenir les réfugiés, ils représentent 40 000 km soit la circonférence de la terre. |
| | | |  sept 2018 - https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/DESCAMPS/59053 sept 2018 - https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/DESCAMPS/59053
« L’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est »
par Philippe Descamps
«Ils nous ont menti à plusieurs reprises, ils ont pris des décisions dans notre dos, ils nous ont mis devant le fait accompli. Cela s’est produit avec l’expansion de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord [OTAN] vers l’est, ainsi qu’avec le déploiement d’infrastructures militaires à nos frontières. » Dans son discours justifiant l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, le 18 mars 2014, le président Vladimir Poutine étale sa rancœur envers les dirigeants occidentaux.
Peu après, la Revue de l’OTAN lui répond par un plaidoyer visant à démonter ce « mythe » et cette « prétendue promesse » : « Il n’y a jamais eu, de la part de l’Ouest, d’engagement politique ou juridiquement contraignant de ne pas élargir l’OTAN au-delà des frontières d’une Allemagne réunifiée » , écrit M. Michael Rühle, chef de la section sécurité énergétique (1). En précisant « juridiquement contraignant » , il révèle le pot aux roses. Des documents récemment déclassifiés (2) permettent de reconstituer les discussions de l’époque et de prendre la mesure des engagements politiques occidentaux envers M. Mikhaïl Gorbatchev en échange de ses initiatives pour mettre fin à la guerre froide.
Dès son arrivée à la tête de l’Union soviétique, en 1985, M. Gorbatchev encourage les pays du pacte de Varsovie à entreprendre des réformes et renonce à la menace d’un recours à la force (lire « Quand la Russie rêvait d’Europe »). Le 13 juin 1989, il signe même avec Helmut Kohl, le chancelier de la République fédérale d’Allemagne (RFA), une déclaration commune affirmant le droit des peuples et des États à l’autodétermination. Le 9 novembre, le mur de Berlin tombe. Une fois l’euphorie passée, les questions économiques deviennent pressantes dans toute l’Europe centrale. Les habitants de la République démocratique allemande (RDA) aspirent à la prospérité de l’Ouest, et un exode menace la stabilité de la région. Le débat sur les réformes économiques devient très rapidement un débat sur l’union des deux Allemagnes, puis sur l’adhésion de l’ensemble à l’OTAN. Le président français François Mitterrand accepte l’évolution, pourvu qu’elle se fasse dans le respect des frontières, de manière démocratique, pacifique, dans un cadre européen (3)... et que l’Allemagne approuve son projet d’union monétaire. Tous les dirigeants européens se disent avant tout soucieux de ménager M. Gorbatchev.
L’administration américaine soutient le chancelier allemand, qui avance à marche forcée. À Moscou, le 9 février 1990, le secrétaire d’État américain James Baker multiplie les promesses devant Édouard Chevardnadze, le ministre des affaires étrangères soviétique, et M. Gorbatchev. Ce dernier explique que l’intégration d’une Allemagne unie dans l’OTAN bouleverserait l’équilibre militaire et stratégique en Europe. Il préconise une Allemagne neutre ou participant aux deux alliances — OTAN et pacte de Varsovie —, qui deviendraient des structures plus politiques que militaires. En réponse, M. Baker agite l’épouvantail d’une Allemagne livrée à elle-même et capable de se doter de l’arme atomique, tout en affirmant que les discussions entre les deux Allemagnes et les quatre forces d’occupation (États-Unis, Royaume-Uni, France et URSS) doivent garantir que l’OTAN n’ira pas plus loin : « La juridiction militaire actuelle de l’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est » , affirme-t-il à trois reprises.
« En supposant que l’unification ait lieu, que préférez-vous ?, interroge le secrétaire d’État. Une Allemagne unie en dehors de l’OTAN, absolument indépendante et sans troupes américaines ? Ou une Allemagne unie gardant ses liens avec l’OTAN, mais avec la garantie que les institutions ou les troupes de l’OTAN ne s’étendront pas à l’est de la frontière actuelle ? » « Notre direction a l’intention de discuter de toutes ces questions en profondeur, lui répond M. Gorbatchev. Il va sans dire qu’un élargissement de la zone OTAN n’est pas acceptable. » « Nous sommes d’accord avec cela » , conclut M. Baker.
Le lendemain, 10 février 1990, c’est au tour de Kohl de venir à Moscou pour rassurer M. Gorbatchev : « Nous pensons que l’OTAN ne devrait pas élargir sa portée, assure le chancelier d’Allemagne occidentale. Nous devons trouver une résolution raisonnable. Je comprends bien les intérêts de l’Union soviétique en matière de sécurité. » M. Gorbatchev lui répond : « C’est une question sérieuse. Il ne devrait y avoir aucune divergence en matière militaire. Ils disent que l’OTAN va s’effondrer sans la RFA. Mais, sans la RDA, ce serait aussi la fin du pacte de Varsovie... »
Face au réalisateur américain Oliver Stone, en juillet 2015, M. Poutine esquisse un rictus en évoquant cet épisode majeur de l’histoire des relations internationales : « Rien n’avait été couché sur le papier. Ce fut une erreur de Gorbatchev. En politique, tout doit être écrit, même si une garantie sur papier est aussi souvent violée. Gorbatchev a seulement discuté avec eux et a considéré que cette parole était suffisante. Mais les choses ne se passent pas comme cela (4) ! »
L’histoire galope. Tous les régimes d’Europe centrale sont tombés. Les seuls gages solides qui restent à l’URSS dans les négociations sont les accords de Potsdam d’août 1945 et la présence de 350 000 soldats soviétiques sur le sol allemand. M. Baker se rend à nouveau à Moscou le 18 mai 1990 pour démontrer à M. Gorbatchev que ses positions sont prises en compte : « L’OTAN va évoluer pour devenir davantage une organisation politique. (…) Nous nous efforçons, dans divers forums, de transformer la CSCE [Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, future OSCE] en une institution permanente qui deviendrait une pierre angulaire d’une nouvelle Europe. » M. Gorbatchev le prend au mot : « Vous dites que l’OTAN n’est pas dirigée contre nous, qu’il s’agit seulement d’une structure de sécurité qui s’adapte à la nouvelle réalité. Nous allons donc proposer de la rejoindre. »
Mitterrand rencontre M. Gorbatchev le 25 mai 1990 à Moscou et lui déclare : « Je tiens à vous rappeler que je suis personnellement favorable au démantèlement progressif des blocs militaires. » Il ajoute : « Je l’ai toujours dit : la sécurité européenne est impossible sans l’URSS. Non parce que l’URSS serait un adversaire doté d’une armée puissante, mais parce que c’est notre partenaire. » Le président français écrit dans la foulée à son homologue américain que l’hostilité de M. Gorbatchev à la présence de l’Allemagne unifiée dans l’OTAN ne lui paraît « ni feinte ni tactique » , en précisant que le dirigeant soviétique « n’a plus guère de marge de manœuvre » .
Malgré la dégradation économique, M. Gorbatchev raffermit son pouvoir. Ayant été élu président de l’URSS en mars, il écarte les conservateurs lors du Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique qui se tient début juillet. Le dernier acte politique se joue le 16 juillet, dans le village montagnard d’Arhiz, dans le nord du Caucase. En échange du retrait des troupes soviétiques de la future Allemagne unie et membre de l’OTAN, Kohl s’engage devant M. Gorbatchev à accepter les frontières de 1945 (ligne Oder-Neisse), à n’avoir aucune revendication territoriale, à diminuer presque de moitié les effectifs de la Bundeswehr, à renoncer à toute arme ABC (atomique, bactériologique ou chimique) et à verser une substantielle « aide au départ » .
L’accord est scellé dans le traité sur la réunification de l’Allemagne signé le 12 septembre 1990 à Moscou. Mais ce texte n’aborde la question de l’extension de l’OTAN qu’à propos du territoire de l’ancienne RDA après le retrait des troupes soviétiques : « Des forces armées et des armes nucléaires ou des vecteurs d’armes nucléaires étrangers ne seront pas stationnés dans cette partie de l’Allemagne et n’y seront pas déployés (5). » À la dernière minute, les Soviétiques renâclent. Pour obtenir leur signature, les Allemands ajoutent un avenant précisant que « toutes les questions concernant l’application du mot “déployés” (...) seront tranchées par le gouvernement de l’Allemagne unie d’une manière raisonnable et responsable prenant en compte les intérêts de sécurité de chaque partie contractante. » Aucun texte ne fixe le sort des autres pays du pacte de Varsovie.
Début 1991, les premières demandes d’adhésion à l’OTAN arrivent de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Pologne et de Roumanie. Une délégation du Parlement russe rencontre le secrétaire général de l’OTAN. Manfred Wörner lui affirme que treize membres du conseil de l’OTAN sur seize se prononcent contre un élargissement, et ajoute : « Nous ne devrions pas permettre l’isolement de l’URSS. »
Ancien conseiller de M. Gorbatchev, M. Andreï Gratchev comprend les motivations des pays d’Europe centrale « tout juste affranchis de la domination soviétique » et ayant toujours en mémoire les « ingérences » de la Russie tsariste. En revanche, il déplore la « vieille politique du “cordon sanitaire” » qui conduira par la suite à un élargissement de l’OTAN à tous les anciens pays du pacte de Varsovie, et même aux trois anciennes républiques soviétiques baltes : « La position des faucons américains est bien moins admissible, révélant une profonde ignorance de la réalité et une incapacité à sortir des carcans idéologiques de la guerre froide (6). »
Philippe Descamps
(1) Michael Rühle, « L’élargissement de l’OTAN et la Russie : mythes et réalités », Revue de l’OTAN, 2014.
(2) « NATO expansion : What Gorbachev heard », National Security Archive, 12 décembre 2017. Sauf mention contraire, toutes les citations sont issues de ces documents.
(3) Cf. Maurice Vaïsse et Christian Wenkel, La Diplomatie française face à l’unification allemande, Tallandier, Paris, 2011.
(4) Oliver Stone, Conversations avec Poutine, Albin Michel, Paris, 2017. Entretiens également diffusés sur France 3, du 26 au 28 juin 2017.
(5) « Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne », www.cvce.eu.
(6) Andreï Gratchev, Un nouvel avant-guerre ? Des hyperpuissances à l’hyperpoker, Alma éditeur, Paris, 2017
Edité le 09-11-2019 à 19:53:14 par Xuan
|
| |  Je poursuis la publication des articles du Diplo sur la chute du mur et ses suites : Je poursuis la publication des articles du Diplo sur la chute du mur et ses suites :
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/RICHARD/59048
lundi
4 novembre 2019
« Aussi longtemps qu’il existera des armes nucléaires, le danger sera colossal » , a déclaré lundi sur la BBC le dernier dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, appelant à leur destruction. En octobre 1986 déjà, Gorbatchev avait fait au président américain Ronald Reagan « une proposition audacieuse : supprimer 50 % des arsenaux nucléaires dans les cinq années à venir et les liquider complètement dans les cinq années suivantes. Reagan acquiesce, mais s’obstine à obtenir les mains libres pour son Initiative de défense stratégique, un bouclier spatial perçu par les Soviétiques comme la recherche d’une supériorité militaire susceptible de relancer la course aux armements — et qui ne verra jamais le jour... »
Trente ans plus tard, la course semble bel et bien relancée : les États-Unis se sont récemment retirés du traité antimissile balistique (ABM) et du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) tandis que les Russes ont dénoncé le traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE) et envisagent de ne pas reconduire, en 2021, le traité New Start de réduction des armes stratégiques…
Des promesses non tenues qui ont créé un sentiment d’humiliation
Quand la Russie rêvait d’Europe
Au sortir de la guerre froide, les Russes voyaient leur avenir dans une Europe réconciliée et dotée de mécanismes de sécurité communs. En portant le glaive de l’Alliance atlantique jusqu’à leur porte, les Occidentaux ont pris le risque d’une réaction nationaliste.
par Hélène Richard
Parfois, l’état des relations entre la Russie et l’Europe se révèle à travers quelques sensations déplaisantes, comme un fourmillement dans les jambes à force de patienter dans une antichambre du Conseil de la Fédération de Russie. Le sénateur Alexeï Pouchkov se méfie de la presse occidentale. « S’il s’agit de sélectionner une ou deux citations, vous n’avez que quinze minutes » , prévient-il dans un français impeccable. Animateur depuis vingt ans de l’émission politique « Post-Scriptum » , sur la chaîne moscovite TV Centre, cet ancien président de la commission des affaires étrangères de la Douma (Chambre basse du Parlement) se laissera interroger pendant une heure et demie.
Depuis l’époque où il écrivait les discours du dernier dirigeant de l’Union soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev, de l’eau a coulé sous les ponts. Il juge rétrospectivement que son ancien mentor, « qui n’était que spécialiste des questions agricoles au sein du parti avant d’arriver au pouvoir » , a fait preuve de « naïveté » . Considéré comme l’un des plus ardents défenseurs de la politique extérieure du président Vladimir Poutine, M. Pouchkov figure depuis la crise ukrainienne de 2014 sur la liste des personnalités interdites d’entrée sur les territoires américain, canadien et britannique.
Sa trajectoire résume celle de la Russie. M. Gorbatchev espérait voir son pays faire son retour au sein de la grande famille des nations européennes. Il s’inscrivait ainsi dans les courants occidentalistes qui, dès Pierre le Grand (1682-1725), cherchent à arrimer la Russie à l’Europe, à l’inverse des slavophiles, qui prônent une voie spécifique (1). À la fin des années 1980, ce tropisme devait revêtir une portée plus générale : l’avènement d’un ordre international débarrassé de la logique des blocs. Difficile de comprendre le comportement actuel de la Russie sans revenir sur l’échec de ce rêve européen.
Lors de son premier déplacement à l’étranger en tant que secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique, à l’automne 1985 à Paris, M. Gorbatchev lance sa formule de « maison commune européenne » à l’intention des dirigeants ouest-européens. Le choix de la capitale française n’est pas anodin. Charles de Gaulle avait défendu l’idée d’une Europe allant « de l’Atlantique à l’Oural » : une Europe des nations, indépendantes de toute tutelle, dans laquelle la Russie aurait renoncé au communisme, que le général prenait pour une lubie passagère. À l’époque, Moscou n’avait guère pris au sérieux sa proposition : l’Union soviétique tenait fermement au maintien de la division de l’Europe, à commencer par celle de l’Allemagne, matérialisation de sa présence au cœur du Vieux Continent.
Le slogan de la « maison commune » vise aussi à favoriser un certain découplage entre Washington et ses alliés européens, pour pousser les États-Unis à négocier. Vu de Moscou, la fin de la course aux armements devient urgente, en raison du poids des dépenses militaires dans le budget. La parité stratégique, garante de la coexistence pacifique, demeure un point d’équilibre précaire. Par deux fois, le monde vient de friser l’anéantissement : en septembre 1983, Stanislav Petrov, un officier de la force antiaérienne basée près de Moscou, déjoue une fausse alerte nucléaire ; puis, en novembre 1983, les Soviétiques s’affolent devant l’exercice Able Archer 83 de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), pensant qu’il camoufle une attaque. « Les scientifiques venaient d’inventer le concept terrifiant d’“hiver nucléaire”, se remémore M. Pouchkov. Je faisais partie de ceux qui voulaient en finir avec la guerre froide. » Lors d’une première rencontre pourtant difficile à Genève, en novembre 1985, le président américain Ronald Reagan et M. Gorbatchev s’accordent sur l’idée qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais avoir lieu.
En octobre 1986, à Reykjavik, le second avance une proposition audacieuse : supprimer 50 % des arsenaux nucléaires dans les cinq années à venir et les liquider complètement dans les cinq années suivantes (2). Reagan acquiesce, mais s’obstine à obtenir les mains libres pour son Initiative de défense stratégique, un bouclier spatial perçu par les Soviétiques comme la recherche d’une supériorité militaire susceptible de relancer la course aux armements — et qui ne verra jamais le jour... Pour surmonter le gouffre de la défiance, M. Gorbatchev fait des concessions unilatérales. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire du 8 décembre 1987 permet ainsi l’élimination de 1 846 missiles soviétiques, plus de deux fois plus que la contrepartie américaine.
« Comme on rentre chez soi »
En 1988, sous la pression des difficultés internes au bloc socialiste, la « maison commune européenne » prend une consistance stratégique. M. Gorbatchev ne pense pouvoir éviter l’effondrement économique qu’en introduisant une dose supplémentaire de propriété privée et de marché dans le système de planification. En Europe de l’Est, les revendications démocratiques le confortent dans sa conviction : l’ouverture politique va dans le sens de l’histoire. La confrontation idéologique remisée, l’objectif n’est plus de coopérer de bloc à bloc, mais de les fondre dans une Europe élargie sur la base de valeurs communes : liberté, droits humains, démocratie et souveraineté. C’est un « retour vers l’Europe (...), civilisation à la périphérie de laquelle nous sommes longtemps restés » , selon les mots, à l’époque, du diplomate Vladimir Loukine (3).
« Le système était à bout de souffle et il fallait se débarrasser, sans aucun doute, du communisme » , estime aujourd’hui M. Alexandre Samarine, premier conseiller à l’ambassade de Russie à Paris, qui rappelle que son pays, membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 2012, est désormais « capitaliste » et « opposé au protectionnisme ». « Tout le monde sentait que nous étions dans une impasse » , abonde un diplomate à la retraite qui souhaite garder l’anonymat. « Mais, s’empresse-t-il d’ajouter, personne ne pensait qu’il fallait faire des concessions unilatérales. »
Marqué par la répression du « printemps de Prague » , en 1968, M. Gorbatchev considère d’emblée comme caduque la doctrine Brejnev sur la souveraineté limitée des « pays frères » . En encourageant les réformateurs et en refusant toute intervention par la force, il a enclenché une mécanique qui finit par lui échapper. À ses concessions, les Occidentaux répondent par des promesses (lire « « L’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est » » ), la question allemande illustrant le marché de dupes qui s’engage.
Après la chute du mur de Berlin, M. Gorbatchev soutient l’idée d’une Allemagne neutre (ou adhérant aux deux alliances militaires, l’OTAN et le pacte de Varsovie), insérée dans une structure de sécurité paneuropéenne qui prendrait pour base la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), créée en 1975 par l’Acte final d’Helsinki. Point d’orgue de la détente Est-Ouest, avant le regain de tension lié à l’intervention soviétique en Afghanistan en 1979, cette déclaration signée par trente-cinq États résultait d’un marchandage entre les deux camps. Les pays occidentaux validaient le principe, défendu depuis des années par Moscou, de l’intangibilité des frontières, reconnaissant ainsi la division de l’Allemagne et les acquis soviétiques en Europe centrale et orientale. En échange, le camp socialiste s’engageait à respecter les droits humains et les libertés fondamentales, « y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction » . Seul organe permanent où siégeaient ensemble les États-Unis, le Canada, l’Union soviétique et tous les pays européens, la CSCE constituait aux yeux de Moscou la première pierre d’un rapprochement des deux Europe.
En 1990, M. Gorbatchev n’est pas seul à défendre l’option paneuropéenne. Les nouveaux dirigeants est-européens, souvent d’anciens dissidents marqués par leur engagement pacifiste, ne souhaitent pas basculer dans le camp occidental. Leur préférence va à la formation d’une région neutre et démilitarisée. Au lendemain de son élection à la présidence de la Tchécoslovaquie, Václav Havel choque les Américains en demandant la dissolution des deux alliances militaires et le départ de toutes les troupes étrangères d’Europe centrale. Le chancelier allemand Helmut Kohl s’irrite des déclarations du premier ministre est-allemand Lothar de Maizière, favorable à la neutralisation de l’Allemagne. En avril 1990, Wojciech Jaruzelski, président de la Pologne, le premier pays à avoir ouvert les élections à des candidats non communistes, accepte la proposition de M. Gorbatchev de renforcer provisoirement les troupes du pacte de Varsovie en Allemagne de l’Est, le temps de mettre en place une structure de sécurité paneuropéenne. Il propose même d’y joindre des forces polonaises. Ce n’est qu’en février 1991 que la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie abandonnent cette option en formant le groupe de Visegrád : craignant le retour des communistes conservateurs à Moscou, elles y affirment leur volonté commune de s’abriter sous le parapluie américain.
Du côté ouest-européen, les dirigeants partagent le souci de poser les bases d’une nouvelle Grande Europe plus autonome vis-à-vis de Washington, même s’ils restent attachés au maintien de l’OTAN. François Mitterrand souhaite insérer l’Allemagne réunifiée dans un système de sécurité européen élargi, ménageant une place pour la Russie. « L’Europe ne sera plus celle que nous connaissons depuis un demi-siècle. Hier dépendante des deux superpuissances, elle va, comme on rentre chez soi, rentrer dans son histoire et sa géographie, déclare-t-il dans ses vœux du 31 décembre 1989. À partir des accords d’Helsinki, je compte voir naître dans les années 1990 une confédération européenne au vrai sens du terme, qui associera tous les États de notre continent. » Cherchant à éviter l’isolement de l’URSS, il dessine une architecture paneuropéenne en cercles concentriques : les douze membres d’alors de la Communauté économique européenne (CEE) devaient former un « noyau actif » à l’intérieur d’une structure de coopération élargie comprenant les anciens pays du pacte de Varsovie. La première ministre britannique Margaret Thatcher cherche elle aussi à inscrire dans un cadre européen cette puissance allemande en voie d’être restaurée. Elle mandate en février 1990 son ministre des affaires étrangères, M. Douglas Hurd, pour pousser dans les négociations l’option d’une « association européenne élargie (...) accueillant les pays est-européens et, à terme, l’Union soviétique (4) » .
M. Gorbatchev n’a pas su tirer profit de cette convergence fugace. Car, fort de la victoire de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) aux premières élections libres en République démocratique d’Allemagne (RDA), en mars 1990, le chancelier Kohl prône l’absorption pure et simple de la RDA par la République fédérale d’Allemagne (RFA). Le temps joue en sa faveur et en celle du président américain George H. Bush, son principal allié. L’Union soviétique a besoin d’argent ; Washington, qui ne peut décemment financer son adversaire, enjoint à Bonn de se montrer généreux. Les 13,5 milliards de deutschemarks promis par l’Allemagne, au titre de contribution au rapatriement des troupes soviétiques, rendent l’URSS plus conciliante.
Avec le traité de réduction des armes stratégiques (Start), en 1991, les Occidentaux ont obtenu une diminution draconienne des arsenaux nucléaires ; les « démocraties populaires » sont tombées les unes après les autres ; mais, lorsque M. Gorbatchev réclame une aide économique lors du sommet du G7 à Londres en juillet 1991, quelques jours après la dissolution du pacte de Varsovie, il n’obtient aucun engagement concret. L’effondrement de l’Union soviétique, en décembre 1991, donne le coup de grâce au projet paneuropéen. L’OTAN intègre par vagues successives les anciennes démocraties populaires, plus les ex-républiques soviétiques baltes (voir la carte ci-dessous). L’Union européenne en fera autant.

Un élargissement sans bornes
Cécile Marin
En 1993, Mitterrand s’offusque de l’adhésion des pays de l’Est à l’OTAN, une alliance qu’il voulait voir devenir plus politique que militaire. Aux États-Unis aussi, quelques voix s’élèvent très tôt contre une dynamique qui risque de provoquer en Russie la réaction nationaliste qu’elle est censée prévenir. Même le père de la doctrine de l’endiguement de l’expansionnisme soviétique en 1946, George F. Kennan, dénonce dès 1997 l’élargissement de l’OTAN comme « la plus fatale erreur de politique américaine depuis la guerre » . Cette décision, dit-il, « va porter préjudice au développement de la démocratie russe, en rétablissant l’atmosphère de la guerre froide (...). Les Russes n’auront d’autre choix que d’interpréter l’expansion de l’OTAN comme une action militaire. Ils iront chercher ailleurs des garanties pour leur sécurité et leur avenir » (5). Critique de l’hubris américaine, M. Jack Matlock, ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991, note que « trop d’hommes politiques américains voient la fin de la guerre froide comme s’il s’agissait d’une quasi-victoire militaire. (...) La question n’aurait pas dû être d’élargir ou non l’OTAN, mais plutôt d’explorer comment les États-Unis pouvaient garantir aux pays d’Europe centrale que leur indépendance serait préservée et, en même temps, créer en Europe un système de sécurité qui aurait confié la responsabilité de l’avenir du continent aux Européens eux-mêmes (6) » .
Exclue des discussions sur l’Ukraine
Dans les années 1990, affaiblie par le chaos économique et social, la Russie ne peut plus défendre ses intérêts géopolitiques. Mais la timidité de sa réaction tient aussi à sa volonté de préserver son statut de grande puissance en tant que partenaire privilégié des Américains. Or, sur ce point, les Occidentaux lui ont laissé quelques raisons d’espérer. Moscou a récupéré son arsenal nucléaire dispersé dans les anciennes républiques soviétiques avec la bénédiction de Washington ; il conserve son siège au Conseil de sécurité des Nations unies ; il se voit offrir d’entrer au club des grandes puissances capitalistes, le G7, qui devient G8. « Il régnait à l’époque une atmosphère d’euphorie, se rappelle l’ancien vice-ministre des affaires étrangères (1986-1990) Anatoli Adamichine. Nous pensions être dans le même bateau que l’Occident (7). » Les dirigeants russes n’entrevoient pas tout de suite l’élargissement de l’OTAN comme une menace militaire. Ils s’inquiètent plutôt de leur isolement, qu’ils s’efforcent de prévenir (8). Dès la chute de l’URSS, Boris Eltsine formule le souhait que son pays rejoigne l’organisation « à long terme ». Son ministre des affaires étrangères Andreï Kozyrev évoque la possibilité de subordonner l’Alliance aux décisions de la CSCE (en passe de devenir l’OSCE, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).
L’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie en 1999, sans mandat des Nations unies, fait prendre à la Russie la mesure de sa relégation. L’Alliance atlantique, dont elle est exclue, lui apparaît alors comme le bras armé d’un camp des vainqueurs si sûr de sa force qu’il entend l’imposer y compris en dehors de sa zone. « Le bombardement de Belgrade par l’OTAN a suscité une très grande déception chez ceux qui, comme moi, croyaient dans le projet de la “maison commune”, nous confie M. Youri Roubinski, premier conseiller politique à l’ambassade de Russie à Paris de 1987 à 1997. L’élan vers l’Europe impulsé par Gorbatchev a cependant continué d’exercer sa force d’inertie positive de nombreuses années. »
Il est généralement admis que l’arrivée d’un ancien agent des services secrets à la tête de l’État russe, en 2000, représente une rupture par rapport aux années Eltsine, présentées comme plus ouvertes sur l’Occident et plus démocratiques. C’est oublier l’initiative très europhile qui marque le premier mandat de M. Poutine, choisi comme successeur par Eltsine. En 2001, à la tribune du Bundestag, il appelle l’Europe à « unir ses capacités au potentiel humain, territorial, naturel, économique, culturel et militaire de la Russie » . Puis, après les attentats du 11-Septembre, la Russie propose une coalition contre le terrorisme inspirée de celle qui a vaincu les nazis durant la seconde guerre mondiale. Mais, trois mois plus tard, les États-Unis, de nouveau en quête de supériorité militaire, annoncent qu’ils sortent du traité antimissile balistique (ABM) signé par Leonid Brejnev et Richard Nixon en 1972.
En février 2007, à Munich, M. Poutine fustige l’unilatéralisme américain : « On veut nous infliger de nouvelles lignes de démarcation et de nouveaux murs. » En 2008, Moscou lance ses troupes pour bloquer l’offensive du président géorgien contre l’Ossétie du Sud et contrecarrer indirectement une nouvelle extension de l’OTAN, cette fois dans le Caucase. Pourtant, il ne renonce pas au dialogue et propose même, en novembre 2009, un traité de sécurité en Europe. La proposition est ignorée.
Rejetée aux marges de l’Europe, la Russie poursuit son projet d’intégration économique régionale avec d’anciennes républiques soviétiques (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Arménie, Ukraine et Biélorussie). Mais, là encore, elle ne cherche pas à tourner le dos à l’Europe, son premier partenaire commercial et la principale destination de ses exportations de gaz. Grâce à ce projet, elle pense au contraire être en meilleure posture pour négocier un partenariat avec l’Union européenne. Aujourd’hui, elle accuse l’Union de l’avoir exclue des discussions sur l’accord d’association avec l’Ukraine, qui a mis le feu aux poudres en 2013-2014. En vertu de ses liens historiques et économiques avec Kiev, la Russie estime qu’elle aurait dû être associée aux discussions, tandis qu’en Europe règne la conviction opposée. « L’idée même de sphère d’influence de la Russie est considérée comme illégitime, analyse le politiste britannique Richard Sakwa, alors que le champ de ses intérêts légitimes et la façon dont elle a le droit de les exprimer restent flous (9). »
« La ligne paneuropéenne s’est brisée sur la Crimée » , reconnaît M. Roubinski. Les dirigeants russes ne se font guère d’illusion sur la possibilité de relancer une relation privilégiée avec l’Europe, qu’ils jugent alignée sur la politique hostile des États-Unis. « Ce qu’on a offert à la Russie n’est pas le Grand Occident, mais l’adhésion à l’Occident dans son acception historique, et dans une position subalterne », résume Sakwa. C’est précisément ce que Moscou ne souhaite plus : « Nous ne supplierons personne [de lever les sanctions économiques mises en place en 2014] » , a prévenu le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse commune avec son homologue belge, le 13 février dernier. Ce partenariat, s’il devait être relancé, s’inscrirait désormais dans une vision qui n’a plus rien à voir avec la vision gorbatchévienne d’un retour à l’Europe. « Le monde a changé. L’époque des blocs et des alliances fermées est finie » , s’agace presque Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de la revue Russia in Global Affairs. « Quand les Européens reviendront à la raison, nous serons toujours prêts à construire cette Grande Europe, ajoute M. Samarine. Nous visons l’intégration des intégrations, c’est-à-dire un rapprochement et une harmonisation de l’Union européenne et de l’Union eurasiatique. »
La Russie voit désormais l’Europe comme un partenaire important, mais plus comme un destin historique. Tout en affirmant que la culture russe constitue « une branche de la civilisation européenne » , M. Lavrov juge « impossible de développer les relations entre la Russie et l’Union européenne comme au temps de la guerre froide, lorsqu’elles étaient au centre des affaires mondiales. Nous devons prendre acte des puissants processus en cours en Asie-Pacifique, au Proche-Orient, en Afrique et en Amérique latine » (10). Moscou prétend incarner un des pôles actifs d’un monde multipolaire. La crise de la zone euro puis le Brexit ont fait perdre à l’Union européenne son attractivité aux yeux des Russes, qui se réjouissent des menaces de découplage entre l’Europe et les États-Unis portées par M. Donald Trump. « Personne ne veut rejoindre un bateau qui coule, nous assure, dans son bureau parisien, M. Gilles Rémy, directeur d’une société de conseil et d’accompagnement pour les investisseurs français dans l’espace post-soviétique. Les Russes sont passés de la fascination à la compassion. » À entendre M. Vladislav Sourkov, proche conseiller de M. Poutine, l’annexion de la Crimée aurait représenté « l’achèvement du voyage épique de la Russie vers l’ouest, le terme de ses nombreuses tentatives infructueuses d’être incorporée dans la civilisation occidentale, de s’apparenter avec la “bonne famille” des peuples européens (11) » . Désormais, Moscou assume sa « solitude géopolitique ».
Hélène Richard
(1) Cf. Marie-Pierre Rey, La Russie face à l’Europe. D’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, Flammarion, coll. « Champs histoire », Paris, 2016.
(2) Cf. Guillaume Serina, Reagan-Gorbatchev. Reykjavik, 1986 : le sommet de tous les espoirs, L’Archipel, Paris, 2016.
(3) Cité par Marie-Pierre Rey, « Gorbatchev et la “maison commune européenne”, une révolution mentale et politique ? », La Revue russe, no 38, Paris, 2012.
(4) Cité par Mary Elise Sarotte, 1989 : The Struggle to Create Post-Cold War Europe, Princeton University Press, 2009.
(5) Cité par Andreï Gratchev, Un nouvel avant-guerre ? Des hyperpuissances à l’hyperpoker, Alma éditeur, Paris, 2017.
(6) Jack Matlock, Superpower Illusions : How Myths and False Ideologies Led America Astray — And How to Return to Reality, Yale University Press, New Haven, 2011.
(7) Lenta.ru, 15 mai 2018.
(8) Kimberly Marten, « Reconsidering NATO expansion : A counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s », European Journal of International Security, vol. 3, no 2, Cambridge, juin 2018.
(9) Richard Sakwa, Russia Against the Rest : The Post-Cold War Crisis of World Order, Cambridge University Press, 2017.
(10) Sergueï Lavrov, « Russia’s foreign policy in a historical perspective », Russia in Global Affairs, no 2, Moscou, avril-juin 2016.
(11) Vladislav Sourkov, « La solitude du métis » (en russe), Russia in Global Affairs, 28 mai 2018.
Edité le 09-11-2019 à 19:55:01 par Xuan
|
| |  En ex-RDA, des citoyens de seconde zone En ex-RDA, des citoyens de seconde zone
Un mur peut en cacher un autre
En Allemagne, les scores importants de l’extrême droite dans plusieurs Länder de l’Est et le malaise de la population ravivent un débat sur les échecs de l’unification. Trente ans plus tard, la plupart des institutions économiques, juridiques ou intellectuelles sont dirigées par des personnalités de l’Ouest.
par Boris Grésillon
En septembre 2018 a paru en Allemagne un livre qui a beaucoup fait parler. Écrit par Mme Petra Köpping, ministre de l’égalité et de l’intégration du Land de Saxe, il traite du manque de reconnaissance des Allemands de l’Est envers l’Allemagne réunifiée et porte un titre provocateur : Integriert doch erst mal uns !, soit « Commencez donc par nous intégrer ! » (1). « Nous » , sous-entendu les Allemands de l’Est, opposés à « eux » , les réfugiés que l’Allemagne a accueillis en nombre sur son sol à partir de l’été 2015 et auxquels elle s’efforce, depuis, de trouver une place. Ce cri du cœur n’émane pas de la ministre elle-même, qui n’appartient pas aux rangs du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), mais à ceux du Parti social-démocrate (SPD). Il dérive des innombrables doléances que Mme Köpping, de par sa fonction, entend et recueille quotidiennement dans sa permanence ou sur le terrain. Ce sont elles qui l’ont finalement décidée à écrire cet essai incisif autant qu’informé.
Publié un an avant les cérémonies du trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin, ce livre, sous-titré Eine Streitschrift für den Osten ( « Un plaidoyer pour l’Est » ) et rédigé par une femme originaire de l’ex-République démocratique allemande (RDA), est une pierre dans le jardin bien ordonné de la réunification allemande. Comment comprendre cette revendication d’intégration de la part de certains Allemands de l’Est ? Et comment en est-on arrivé là ?
Une donnée-clé de ce « malaise oriental » tient à la quasi-absence d’Allemands originaires de l’Est aux plus hautes fonctions politiques, économiques et culturelles du pays. La disproportion frappe dès lors qu’on tente de la mesurer. On ne trouve ainsi au sommet de l’État qu’une petite poignée de personnes nées ou socialisées dans la partie orientale de l’Allemagne. Certes, Mme Angela Merkel, chancelière depuis 2005 et cheffe de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de 2000 à 2018, a grandi en RDA. Mais, pour accéder à ces deux postes de pouvoir et s’y maintenir, elle a justement dû gommer ses origines. Longtemps, Mme Merkel, M. Wolfgang Thierse — président du Bundestag de 1998 à 2005 — ou encore M. Joachim Gauck — ancien pasteur et président de la République fédérale de 2012 à 2017 — ont incarné aux yeux de leurs compatriotes et des Européens la réussite politique des Ossis (les habitants de l’Est) dans l’Allemagne réunifiée. Toutefois, sans disciples, protégés ni successeurs dans les rangs est-allemands, ils n’étaient que les arbres cachant la forêt, laquelle paraît aujourd’hui bien dénudée.
Au tournant des années 2017-2018, à l’heure de former son cabinet, Mme Merkel n’a choisi dans un premier temps que des ministres ouest-allemands. C’est le SPD, partenaire de la CDU au sein de la « grande coalition » issue des élections fédérales du 24 septembre 2017, qui est intervenu in extremis pour trouver parmi ses membres une femme originaire de l’Est, Mme Franziska Giffey, quasi inconnue, et la proposer comme ministre de la famille. Certains commentateurs ont ironisé sur cet Ostquote, ce « quota de l’Est » (et de femmes) aux relents néocolonialistes remis au goût du jour par le gouvernement.
La règle du plafond de verre
À l’échelle des formations politiques, le constat est plus sévère encore. Les partis de gouvernement n’ont que des Ouest-Allemands à leur tête, qu’il s’agisse de la CDU (Mme Merkel mise à part), du SPD, du Parti libéral-démocrate (FDP) ou des Verts. Même l’AfD, très bien implantée dans l’est du pays, est dirigée par des Wessis. Seul le parti de gauche Die Linke maintient peu ou prou une parité Est-Ouest au sein de sa direction pour des raisons historiques — il a été fondé sur les ruines de l’ancien Parti du socialisme démocratique de RDA (PDS). Cependant, depuis le retrait de son chef emblématique, M. Gregor Gysi, puis, en mars 2019, de Mme Sahra Wagenknecht, il a perdu ses deux principaux ténors est-allemands.
Au sein de la haute administration, les citoyens des nouveaux Länder — les régions de l’ex-RDA — ne tiennent que 5 % des postes, alors qu’ils forment 17 % de la population totale. Une étude menée par l’université de Leipzig en 2016 a montré que les Allemands de l’Est ne représentent que 1,7 % des hauts fonctionnaires et des cadres dirigeants, soit un dixième de leur part dans la population (2). Sur les cent vingt chefs de département des ministères fédéraux (les Abteilungsleiter, aux pouvoirs très étendus), trois seulement viennent de l’Est ; ils sont trois également sur les soixante secrétaires d’État du gouvernement en 2016. La règle bien connue du plafond de verre s’applique donc parfaitement : plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve d’Allemands de l’Est.
Dans le domaine de l’économie et des affaires, leur absence aux postes de pouvoir interroge. Ici, les chiffres ne sont pas seulement cruels ; ils sont accablants. Parmi les présidents-directeurs généraux des trente plus grandes entreprises allemandes cotées en Bourse (le DAX), aucun n’est originaire de l’Est, et cinq seulement des deux cents membres de leurs conseils d’administration le sont, selon le magazine Der Spiegel (novembre 2018). D’ailleurs, pas un de ces grands groupes n’a son siège social dans la partie orientale du pays, Berlin compris. La domination occidentale s’observe à l’intérieur même des nouveaux Länder : les Wessis dirigent les trois quarts des cent plus grandes entreprises de l’Est (3), où ils représentent 77 % des cadres supérieurs. Enfin, 92,7 % des millionnaires allemands habitent à l’Ouest, contre seulement 3,9 % à l’Est et 3,4 % à Berlin (4).
Les secteurs que l’on aurait pu penser plus ouverts au brassage ne le sont en réalité pas davantage. Pratiquement toutes les grandes institutions culturelles du pays ont à leur tête des Allemands de l’Ouest, y compris... à l’Est. Il existe quelques exceptions, comme les Berliner Festspiele, un festival dirigé par M. Thomas Oberender, lequel constate avec une certaine amertume que « les élites des nouveaux Länder sont dominées de manière éclatante par l’Ouest (5) ». Ainsi, les quinze universités situées à l’Est sont toutes présidées par des Allemands de l’Ouest. La plupart des chaires y sont occupées par des professeurs ouest-allemands — jusqu’à 80 % en sciences sociales.
Dans le monde des médias, le compte n’y est pas non plus. Tous les grands groupes (Springer, Funke, Burda, Bertelsmann, Gruner + Jahr...), les principaux quotidiens à diffusion fédérale (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Frankfurter Rundschau, Die Tageszeitung, Der Tagesspiegel), ainsi que les grands magazines hebdomadaires (Der Spiegel, Die Zeit, Stern, Focus), proviennent de l’ex-République fédérale. Seuls subsistent — si l’on excepte la presse quotidienne régionale — la Berliner Zeitung et le Berliner Kurier, qui s’adressent plutôt à un lectorat est-berlinois vieillissant. Même l’hebdomadaire Der Freitag, clairement orienté à gauche et qui se fait volontiers l’écho des problématiques est-allemandes, n’emploie plus que deux journalistes permanents originaires de l’Est.
Cette situation prend sa source dans les conditions de ce que les médias et les dirigeants occidentaux ont appelé la « réunification », au lendemain de la chute du Mur. Le processus fut vécu par les Allemands de l’Est comme un grand bouleversement et, pour certains, une annexion (lire « Allemagne de l’Est, histoire d’une annexion »). Sitôt les institutions de la RDA dissoutes, le 3 octobre 1990, a commencé un mouvement de purge visant à débarrasser l’élite est-allemande des adhérents du Parti socialiste unifié (SED) et des partisans du gouvernement déchu. Dans les domaines administratif, économique, politique, culturel, universitaire, une nouvelle classe dirigeante s’est installée. Venue de l’Ouest, plutôt jeune, bien formée, elle était ravie d’occuper d’emblée des postes importants dans les Länder orientaux fraîchement annexés à la République fédérale. Un million de fonctionnaires ont ainsi perdu leur emploi, dont 70 000 enseignants du supérieur et la totalité des magistrats pénalistes (juges et procureurs), chassés des tribunaux. Le jeu de la reproduction sociale, des réseaux d’influence et de connaissances a perpétué la prédominance de ce groupe dans les générations suivantes. S’il n’y a pas eu de volonté explicite d’écarter les Allemands de l’Est, il n’y a pas eu non plus d’effort pour leur faire une place. En 2016, sur les 202 généraux et amiraux, on n’en trouvait que deux originaires de l’Est. C’était le cas de seulement trois des 336 juges siégeant dans les cours suprêmes fédérales et de 13 % des juges officiant sur le territoire de l’ex-RDA (6).
La rareté des Allemands de l’Est aux postes de pouvoir tient aussi à des raisons économiques. Après l’unification de 1990, ces derniers ont subi un séisme social qui les a durablement éloignés de toute ambition de carrière — une disposition d’ailleurs peu encouragée en régime socialiste. Comme l’explique Frauke Hildebrandt, professeure en sciences de l’éducation à l’université de Potsdam et présidente de la commission de l’Est du SPD en Brandebourg (commission chargée des problèmes structurels rencontrés en Allemagne de l’Est), toutes les familles est-allemandes ont connu la perte brutale d’un emploi, le chômage de longue durée, la fermeture des usines, entreprises d’État, services administratifs. Toutes ont vécu le déclassement, les petits boulots précaires, la rupture des liens professionnels et amicaux, mais aussi la séparation des couples du fait de l’émigration vers l’Ouest. Toutes ont fait l’expérience de la disparition d’un monde qui ne se résumait pas à la Stasi, au Mur ni au Parti. Dans les années 1990, décennie de tous les dangers, il s’agissait de sauver sa peau avant d’envisager de faire carrière.
Introduire des quotas ?
Beaucoup s’y sont employés en tentant l’aventure du côté occidental, provoquant ainsi l’autre drame de l’ex-RDA : la saignée démographique. Dès 1990, on vit s’installer à l’Ouest, souvent avec succès, des dizaines puis des centaines de milliers d’Allemands de l’Est, jeunes et diplômés, majoritairement des femmes. Les nouveaux Länder ne se sont jamais remis de cette hémorragie d’habitants — près de deux millions —, dont une fraction aurait pu occuper des postes à responsabilité à l’Est.
Aujourd’hui, un nombre non négligeable d’Allemands se perçoivent comme des citoyens de seconde zone, laissés sur le bord du chemin par un néolibéralisme imposé de l’extérieur : chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs précaires ou à temps partiel, retraités pauvres ou encore, tout simplement, personnes déçues par les promesses mirobolantes d’un monde certes « libre », mais dépourvu de but et de sens. Sur le plan politique, leur non-intégration se traduit par l’abstention et par un vote d’opposition, d’abord pour le PDS, devenu Die Linke dans les années 2000, puis de plus en plus après 2010 pour l’AfD — deux phénomènes nettement plus marqués à l’Est qu’à l’Ouest (7). À sa manière, la césure politique entre les deux parties de l’Allemagne s’exprime dans ce cri du cœur : « Intégrez-nous donc d’abord ! »
Deux analyses complémentaires rendent compte de cette « absence ». L’une rejoint la problématique du plafond de verre. Au-delà de la situation économique fragile — bien qu’en nette amélioration depuis 1990 —, la population originaire d’Allemagne de l’Est, du fait de sa sous-représentation au sein des élites, ne se sentirait pas appartenir à la « nation retrouvée (8) » annoncée avec empressement au lendemain de la chute du Mur. Tandis que les uns parient sur le temps, puissant dissolvant des amertumes qui achèvera d’unifier le pays, d’autres, souvent venus de l’Est, réclament l’introduction de quotas dans les postes de direction, à proportion de la part des Allemands de l’Est dans la population totale. Le temps ne changera rien à l’affaire, expliquent-ils, car la colère, la résignation et la frustration des Ossis se transmettent d’une génération à l’autre. L’idée des quotas — qui, à en croire les sondages, ne séduit que 48 % des Allemands de l’Est — fait en tout cas couler beaucoup d’encre (9).
Une autre interprétation met en avant un facteur d’ordre plus structurel. En effaçant de l’histoire la RDA telle qu’elle fut vécue par ceux qui y sont nés (10), en rasant ses monuments symboliques — à l’instar de l’ancien Palais de la République, à Berlin —, en réduisant ses habitants au statut soit de victimes d’une dictature totalitaire, soit de mouchards de la police, enfin en monopolisant les postes de pouvoir, les vainqueurs de la guerre froide ont fait naître à l’Est un sentiment que nul quota ne pourra apaiser : celui de ne pas se sentir appartenir à son propre pays.
Boris Grésillon
Professeur de géographie à l’université d’Aix-Marseille, chercheur associé au Centre Marc-Bloch (Berlin).
(1) Petra Köpping, Integriert doch erst mal uns ! Eine Streitschrift für den Osten, Ch. Links Verlag, Berlin, 2018.
(2) Michael Bluhm et Olaf Jacobs, « Wer beherrscht den Osten ? Ostdeutsche Eliten ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung », université de Leipzig, en collaboration avec la chaîne de télévision Mitteldeutscher Rundfunk, 2016.
(3) Ibid.
(4) Manager Magazin, Hambourg, automne 2018.
(5) Stefan Braun, « “Dieses Land wird vom Westen dominiert” », Süddeutsche Zeitung, Munich, 2 mars 2018.
(6) Michael Bluhm et Olaf Jacobs, op. cit.
(7) Cf. Béatrice von Hirschhausen et Boris Grésillon, « La permanence de la partition allemande », Hérodote, numéro « Géopolitique de l’Allemagne », qui paraît ce mois-ci.
(8) Anne-Marie Le Gloannec, « La nation retrouvée. De la RDA à l’Allemagne », Politique étrangère, Paris, no 55-1, 1990.
(9) « Verhilft sie Ostendeutschen zu mehr Chancengleichheit ? », Die Zeit, Hambourg, 21 mars 2019.
(10) Cf. Sonia Combe, D’Est en Ouest, retour à l’archive, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2013, et Nicolas Offenstadt, Le Pays disparu. Sur les traces de la RDA, Stock, Paris, 2018. |
| |  Il y a trente ans, la chute du mur de Berlin Il y a trente ans, la chute du mur de Berlin
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/11/KNAEBEL/60911
Allemagne de l’Est, histoire d’une annexion
Mythe fondateur de l’Union européenne, l’année 1989 est pourtant un symbole équivoque. Ainsi, en Allemagne de l’Est, l’accès aux libertés politiques et à la consommation de masse fut payé au prix fort — celui d’un effondrement social et d’une prédation économique souvent ignorés à l’Ouest.
par Rachel Knaebel & Pierre Rimbert
L’exultation, la liberté, un violoncelliste virtuose jouant au pied d’un mur ébréché, d’autres possibles, la promesse de « paysages florissants (1) » : la geste du 9 novembre 1989 se chante d’ordinaire sur l’air de l’Hymne à la joie. Mais, depuis quelques mois, la discordance entre le grand récit de la « réunification » et la violence qui suivit cette révolution dite pacifique apparaît au grand jour. Avec les scores supérieurs à 20 % obtenus cette année par le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) dans plusieurs Länder de l’ancienne République démocratique allemande (RDA), les sondages où « 58 % des Allemands de l’Est ont le sentiment de n’être pas mieux protégés de l’arbitraire étatique qu’en RDA » (Die Zeit, 3 octobre 2019), le succès d’ouvrages qui dévoilent les années 1990 du point de vue des « perdants », la commémoration de la chute du Mur prend une tonalité moins triomphale que les précédentes. Quelque chose cloche dans la belle histoire d’une généreuse Allemagne de l’Ouest offrant à son voisin ruiné par quatre décennies de dictature communiste le deutschemark et la démocratie.
À l’automne 1989, la population de la RDA écrit sa propre histoire. Sans concours extérieur, les manifestations de masse à Berlin, Leipzig, Dresde destituent l’État-parti dirigé par le Parti socialiste unifié (SED), sa police politique, ses médias aux ordres. Dans les semaines qui suivent la chute du Mur, l’écrasante majorité des opposants au régime aspire non pas à l’unification, mais à une RDA démocratique — à 71 %, selon un sondage du Spiegel (17 décembre 1989). Les propos d’un pasteur lors du rassemblement monstre du 4 novembre 1989 sur l’Alexanderplatz à Berlin traduisent cet état d’esprit : « Nous autres Allemands avons une responsabilité devant l’histoire, celle de montrer qu’un vrai socialisme est possible (2). »
Même tonalité dans l’appel « Pour notre pays » lancé le 26 novembre et présenté à la télévision nationale par l’écrivaine Christa Wolf. « Nous avons encore la possibilité de développer une alternative socialiste à la RFA [République fédérale d’Allemagne] » , affirme ce texte qui recueillera 1,2 million de signatures — sur 16,6 millions d’habitants. Réunis au sein de la Table ronde, créée le 7 décembre sur le modèle polonais et hongrois pour « préserver l’indépendance » du pays et rédiger une Constitution, mouvements d’opposition et partis traditionnels esquissent les contours d’un socialisme démocratique et écologique. L’irruption des forces politiques ouest-allemandes neutralise bientôt cette mobilisation.
Un temps sidérés par les événements, les dirigeants de Bonn — alors capitale de la RFA — se lancent à la conquête électorale du pays voisin. Leur ingérence dans le scrutin législatif du 18 mars 1990, le premier soustrait à l’influence de l’État-parti et de Moscou, est telle qu’Egon Bahr, ancien ministre social-démocrate et artisan dans les années 1970 du rapprochement entre les deux Allemagnes, parle des « élections les plus sales [qu’il ait] observées dans [sa] vie (3) » . Fort du soutien des États-Unis et de la passivité d’une URSS affaiblie, la République fédérale dirigée par le chancelier conservateur Helmut Kohl procède en quelques mois à un spectaculaire coup de force : l’annexion d’un État souverain, la liquidation intégrale de son économie et de ses institutions, la transplantation d’un régime de capitalisme libéral.
Pourtant, quatre décennies après la fondation de la RDA, en 1949, la population avait forgé une identité spécifique, marquée, d’un côté, par les conquêtes socialistes en matière de travail, de solidarité, de santé, d’éducation, de culture et, de l’autre, par une hostilité craintive envers l’État-parti autoritaire, par un repli sur la sphère privée et par un attrait pour l’Ouest. Les architectes de la « réunification » s’aviseront un peu tard qu’on ne dissout pas un peuple comme on ferme un combinat.
Pour comprendre la malfaçon de l’histoire officielle, à laquelle nul ou presque ne croit à l’Est, il faut se débarrasser du mot même qui la résume : il n’y a jamais eu de « réunification » . À cet égard, M. Wolfgang Schäuble, ministre de l’intérieur de la RFA chargé des négociations du traité d’unification, tient à la délégation est-allemande, au printemps 1990, des propos sans ambiguïté : « Chers amis, il s’agit d’une entrée de la RDA dans la République fédérale, et pas du contraire. (…) Ce qui se déroule ici n’est pas l’unification de deux États égaux (4). » Plutôt que de faire voter aux deux peuples allemands rassemblés une nouvelle Constitution, conformément à la Loi fondamentale de la RFA (article 146) et au souhait des mouvements civiques, Bonn impose l’annexion pure et simple de son voisin, en vertu d’une obscure disposition utilisée en 1957 pour rattacher la Sarre à la République fédérale. Signé le 31 août 1990 et entré en vigueur le 3 octobre suivant, le traité d’unification étend simplement la Loi fondamentale ouest-allemande à cinq nouveaux Länder créés pour l’occasion, effaçant d’un trait de plume un pays, dont on ne retiendra plus désormais que l’inflexible dictature policière, le kitsch vestimentaire et la Trabant.
Une union monétaire accélérée
Deux forces inégales s’opposent alors. Les Allemands de l’Est désirent les libertés politiques et la prospérité, mais sans renoncer aux caractéristiques de leur société. Pour Bonn, explique l’universitaire italien Vladimiro Giacché, auteur d’une éclairante étude intitulée Le Second Anschluss, « la priorité est la liquidation absolue de la RDA (5) » .
La première étape consiste à remplir simultanément les urnes et les porte-monnaie, deux objets passablement négligés par l’État-SED. Quand Kohl propose, le 6 février 1990, d’étendre à l’Est le deutschemark de l’Ouest, il poursuit plusieurs objectifs. Il entend d’abord arrimer fermement la RDA à l’Ouest au cas où le très accommodant Mikhaïl Gorbatchev serait renversé à Moscou. Mais il s’agit surtout de remporter les élections législatives prévues en RDA le 18 mars. Or les sondages créditent le Parti social-démocrate (SPD), fraîchement créé, d’une large avance sur l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de l’Est, qui participe depuis des décennies au gouvernement dominé par les communistes. La solution d’une « intégration immédiate de l’économie de la RDA dans l’aire économique et monétaire du deutschemark (6) » concilie les deux exigences. Inspirée notamment par le spécialiste des questions monétaires Thilo Sarrazin — qui deviendra célèbre vingt ans plus tard avec son livre xénophobe L’Allemagne disparaît —, elle émerge en janvier 1990 au ministère des finances à Bonn. Jusque-là sceptique, le chancelier Kohl adopte début février l’idée d’une union monétaire immédiate, sans tenir le moindre compte de l’opposition du président de la Bundesbank — théoriquement indépendante —, qui mangera son chapeau.
Vis-à-vis du public, cette perspective agit comme un formidable accélérateur de campagne. Le mark de l’Ouest valant à ce moment 4,4 marks de l’Est, la promesse d’un échange immédiat au taux de un pour un enthousiasme les habitants de l’Est, familiers des pénuries. Et installe le thème de l’unification des deux États au cœur de la campagne. La CDU et ses alliés refont leur retard et remportent le scrutin avec plus de 48 % des suffrages, contre 21 % pour le SPD et 16 % pour le Parti du socialisme démocratique (PDS, issu du SED). Mais derrière l’ « acte de générosité politique de la République fédérale allemande » loué par M. Lothar de Maizière, chef de la CDU de l’Est et grand vainqueur des élections, se cache une décision politique : celle d’ « assurer, au moyen du mark, l’annexion rapide de la RDA à la RFA » , comme l’observera Mme Christa Luft, ministre de l’économie du 18 novembre 1989 au 18 mars 1990 (7).
Le choix de la démolition sociale
Avec la monnaie, c’est l’ensemble de l’économie de marché qui se trouve d’un coup transplantée en RDA. « On ne pouvait donner le deutschemark qu’en échange d’une transformation complète du système économique » , se souvient M. Sarrazin. Les termes du traité signé le 18 mai entérinent un changement de régime. « L’union économique repose sur l’économie sociale de marché en tant qu’ordre économique commun des deux parties contractantes. Ce dernier est déterminé en particulier par la propriété privée, la concurrence, la liberté des prix ainsi que par la libre circulation fondamentale de la main-d’œuvre, des capitaux, des biens et des services » (article premier). Dès lors qu’elles contredisent le libéralisme politique, le libre-échange ainsi que « la propriété des investisseurs privés sur les terres et les moyens de production », « les dispositions de la Constitution de la République démocratique allemande sur les fondements jusque-là socialistes de la société et de l’État ne seront plus appliquées » (article 2).
Peu après la mise en œuvre du traité, le 1er juillet 1990, et la ruée vers les banques qui s’ensuit, les Allemands de l’Est déchantent. Tandis que les consommateurs se tournent frénétiquement vers les marchandises de l’Ouest, les prix réels des biens et des services produits à l’Est bondissent de 300 à 400 %, et les entreprises perdent d’un coup toute compétitivité. Les voici privées non seulement du marché intérieur, capté par les groupes occidentaux, mais également de leurs clients de l’Est, notamment l’URSS, qui absorbent alors 60 à 80 % des exportations est-allemandes. De l’aveu même de l’ex-président de la Bundesbank Karl Otto Pöhl, le pays avale alors « un remède de cheval qu’aucune économie ne serait en mesure de supporter (8) » . Convaincus comme le médecin de Molière des vertus de la saignée, les négociateurs de Bonn refusent toute contre-mesure de soutien (alignement progressif du taux de change, subvention de la production à l’Est, surtaxe des produits de l’Ouest).
En une nuit, la RDA accomplit la libéralisation économique que l’Allemagne occidentale avait menée après-guerre en une décennie. En juillet, la production industrielle chute de 43,7 % par rapport à l’année précédente, de 51,9 % en août et de près de 70 % fin 1991, tandis que le nombre officiel de chômeurs grimpera d’à peine 7 500 en janvier 1990 à 1,4 million en janvier 1992 — plus du double en comptant les travailleurs au chômage technique, en reconversion ou en préretraite. Aucun pays d’Europe centrale et de l’Est sorti de l’orbite soviétique ne réalisera plus mauvaise performance…
Le choix de la démolition sociale fut délibéré : des dizaines de rapports en avaient détaillé les conséquences. « Plutôt parvenir à l’unité avec une économie ruinée que demeurer plus longtemps dans le bloc soviétique avec une économie à moitié ruinée » , estimait le théologien social-démocrate Richard Schröder (9). C’est peu dire que sa prière fut exaucée. Dans l’esprit des Ossis — les habitants de l’Est , l’ange exterminateur porte un nom : la Treuhand, abrégé de Treuhandanstalt, ou « agence fiduciaire » . Créée le 1er mars 1990, elle sera l’outil de conversion de l’ex-RDA au capitalisme. La Treuhand s’acquitte de sa mission en privatisant ou en liquidant la quasi-totalité du « patrimoine du peuple » — nom donné aux entreprises et aux biens d’État dont elle reçoit la propriété le 1er juillet 1990. À la tête de 8 000 combinats et sociétés, avec leurs 32 000 établissements — des aciéries aux colonies de vacances en passant par les épiceries et les cinémas de quartier —, d’une surface foncière représentant 57 % de la RDA, d’un empire immobilier, cette institution devenue en une nuit le plus grand conglomérat du monde préside aux destinées de 4,1 millions de salariés (45 % des actifs). À sa dissolution, le 31 décembre 1994, elle a privatisé ou liquidé l’essentiel de son portefeuille et peut s’enorgueillir d’un bilan sans équivalent dans l’histoire économique contemporaine : une ex-RDA désindustrialisée, 2,5 millions d’emplois détruits, des pertes évaluées à 256 milliards de marks pour un actif net initial estimé par son propre président, en octobre 1990, à 600 milliards (10) !
Ce prodige du libéralisme représente pour Mme Luft, dernière ministre de l’économie de la RDA, « la plus grande destruction de capital productif en temps de paix (11) » . Les chercheurs Wolfgang Dümcke et Fritz Vilmar y voient de leur côté un temps fort de la colonisation structurelle subie par la RDA (12) : investisseurs et entreprises ouest-allemandes ont racheté 85 % des sites de production est-allemands ; les Allemands de l’Est, 6 % seulement.
L’idée d’une guerre-éclair contre l’économie planifiée du voisin remonte aux années 1950. Auteur en 2018 d’une somme sur la Treuhand, l’historien Markus Böick attribue à Ludwig Erhard, ministre de l’économie de l’après-guerre et gardien du temple ordolibéral, la paternité intellectuelle de cette étrange créature bureaucratique. Dans son essai prospectif sur les « problèmes économiques de la réunification » , paru en 1953, Erhard plaidait pour une union monétaire rapide et livrait, écrit Böick, le « modèle, qui n’était pas du tout sans alternatives, d’une “thérapie de choc” (13) » .
Ironie de l’histoire, la Treuhand créée en mars 1990 ne vise initialement pas à privatiser l’économie. Imaginée dans les cercles dissidents et les mouvements civiques, cette « société fiduciaire pour la préservation des droits des citoyens est-allemands sur le patrimoine du peuple de RDA » devait redistribuer les parts des entreprises d’État à la population. Le syndicat IG Metall proposait de son côté d’en transmettre la propriété directement aux salariés. Mais le triomphe des conservateurs aux élections est-allemandes du 18 mars rebat les cartes. Deux semaines avant l’entrée en vigueur de l’union monétaire, le 1er juillet, la Volkskammer — le Parlement est-allemand — adopte dans l’urgence une « loi pour la privatisation et l’organisation du patrimoine du peuple » . Ainsi s’achève la recherche d’un compromis entre socialisme et capitalisme, qui animait depuis la chute du Mur la pensée économique réformiste en RDA. La « thérapie de choc » pensée un demi-siècle plus tôt s’impose.
Mise sur pied en quelques semaines, la Treuhand entame ses travaux dans l’improvisation. En l’absence de réseau téléphonique commun aux deux Allemagnes, ses employés de Berlin-Est se rendent à heure fixe dans les cabines téléphoniques de Berlin-Ouest pour échanger avec leurs interlocuteurs occidentaux (14). Ce côté artisanal n’empêche pas qu’accoure au chevet de l’organisme tout ce que la RFA compte de professionnels de la restructuration d’entreprises. Son premier président, M. Reiner Maria Gohlke, ex-directeur général d’IBM, cède la place en août 1990 à Detlev Karsten Rohwedder, président du groupe métallurgique Hoesch. La présidence du conseil de surveillance échoit à M. Jens Odewald, proche du chancelier Kohl et président d’une chaîne de grands magasins ouest-allemands, Kaufhof, qui acquerra les juteux commerces de l’Alexanderplatz. Dès l’été 1990, Bonn supervise les opérations : le ministère des finances installe auprès de la présidence de la Treuhand un cabinet peuplé de cadres issus de sociétés de conseil comme KPMG, McKinsey, Roland Berger, qui évalueront sans critères précis les entreprises vouées au redressement, à la privatisation sans délai ou à la liquidation (15).
Des entreprises dépecées
Une série de décisions absurdes ainsi que la collusion entre la Treuhand, le gouvernement conservateur et le patronat ouest-allemand ont nourri la conviction — jamais démentie — que la Treuhand avait d’abord agi pour éliminer du marché toute concurrence susceptible de faire baisser les marges des groupes ouest-allemands. Asphyxiée et peu performante, l’économie est-allemande comptait tout de même quelques fleurons. Le 2 octobre 1990, la veille de la réunification, la direction de la Treuhand décide par exemple de fermer l’usine de fabrication d’appareils photographiques Pentacon, à Dresde, qui emploie 5 700 personnes et exporte son modèle Praktica vers de nombreux pays de l’Ouest.
En matière d’écologie, l’une des rares réalisations de la RDA se nomme Sero, la société nationale de recyclage et de réutilisation des matériaux. Lorsque les communes demandent sa métamorphose en un réseau d’entreprises municipales, la Treuhand refuse, privilégiant une vente à la découpe au profit de groupes de l’Ouest. L’acharnement de l’agence à détruire la compagnie aérienne Interflug, largement bénéficiaire, pour transférer gratuitement les droits d’exploitation de ses lignes et l’usage de son aéroport au concurrent ouest-allemand Lufthansa relève de la caricature. Dans le village minier de Bischofferode, en Thuringe, il sera désormais difficile de vendre aux habitants le principe de la concurrence libre et non faussée. En 1990, la Treuhand réunit en une seule entité toutes les mines de potasse et les cède au concurrent de l’Ouest, l’entreprise K + S, laquelle décide aussitôt d’arrêter leur activité. « Bischofferode est un exemple d’entreprise compétitive fermée en raison de la concurrence ouest-allemande, nous explique M. Dietmar Barstsch, député du parti de gauche Die Linke. Il fallait montrer que la RDA était finie, qu’il n’y avait rien en elle de valable. »
Aux suppressions d’emplois par centaines de milliers répondent les protestations. En mars 1991, les 20 000 ouvrières du textile de Chemnitz (Saxe) menacées de licenciement, les 25 000 travailleurs de la chimie qui occupent leurs usines en Saxe-Anhalt, les 60 000 personnes qui manifestent à l’appel d’IG Metall, mais aussi des Églises évangéliques et d’anciens opposants ne luttent plus pour la liberté politique, mais contre le libéralisme économique. Le 30 mars, un groupe incendie un bureau de l’agence berlinoise de la Treuhand ; le lendemain, le directeur de l’institution, Rohwedder, est abattu. Recrutée par le cabinet Roland Berger, Mme Birgit Breuel, membre de la CDU et fanatique des privatisations, le remplace aussitôt.
Magouilleurs du dimanche, charlatans et escrocs en bande organisée comprennent vite que la Treuhand fonctionne comme un distributeur d’argent public ouvert à quiconque prétend racheter l’un de ses actifs. Comme l’organisme néglige de vérifier le casier judiciaire et les références de ses clients, les scandales se multiplient : détournement de subventions dans le cadre de la vente de la raffinerie de Leuna à Elf-Aquitaine en 1991 ; cadres corrompus découverts en 1993 à l’agence de Halle ; siphonnage de centaines de millions de marks accordés à l’ouest-allemand Bremer Vulkan pour redresser les chantiers navals de Rostock et Wismar — 15 000 licenciements à la clé. Les malversations se succèdent à un rythme si soutenu qu’un terme spécifique apparaît : « criminalité de l’unification » (Vereinigungskriminalität). En 1998, une commission parlementaire situe leur montant entre 3 et 6 milliards de marks (16), auxquels on serait tenté d’ajouter les émoluments somptueux des liquidateurs (44 000 marks de prime par privatisation, 88 000 en cas de dépassement d’objectif), ainsi que le coût exorbitant des consultants : en quatre ans d’activité, les collaborateurs externes de la Treuhand ont englouti 1,3 milliard de marks, dont 460 millions en conseils pour la seule année 1992 (17).
« Ce que nous ratons aujourd’hui va nous poursuivre pendant les vingt, trente prochaines années » , avait admis en juillet 1990 le directeur de la Treuhand (18). Dans la petite ville de Großdubrau, en Saxe, la liquidation de l’usine de céramique, recommandée par le cabinet d’audit KPMG malgré la candidature de repreneurs sérieux, demeure dans toutes les mémoires. Aux élections régionales du 1er septembre 2019, plus de 45 % des électeurs ont voté pour l’AfD. Mme Petra Köpping, ministre sociale-démocrate de l’égalité et de l’intégration du Land de Saxe (lire « Un mur peut en cacher un autre » ), y voit un lien de cause à effet. « Il faut rendre des comptes aux gens, sur place, à propos de ce qui s’est passé avec la Treuhand » , recommande-t-elle, et mettre en place « une commission vérité » .
« Zombie mémoriel »
En 1993-1994 puis en 1998, deux commissions d’enquête parlementaires ont exposé la partie émergée de l’iceberg, en dépit de l’obstruction du ministère des finances, qui empêche la consultation des dossiers et des contrats. « Le gouvernement et la Treuhandanstalt ont abrogé le droit de contrôle parlementaire comme aucun gouvernement démocratique légitime n’avait osé le faire depuis 1945 » , dénonçaient des députés sociaux-démocrates en août 1994 (19). Puis le sujet a disparu du débat public. Qui, après tout, se soucie des Jammerossies — ces « gens de l’Est pleurnichards » , comme on les appelle à l’Ouest ?
Depuis quelques années, le spectre de la Treuhand resurgit. « Auparavant, les gens avaient encore de l’espoir, analyse Mme Köpping. Ils se disaient : “J’essaie encore une fois de m’en sortir, encore une formation, encore une reconversion.” Cela a duré longtemps. Mais, une fois à la retraite, cette génération qui se perçoit comme celle de la construction après la réunification se retrouve avec une pension de parfois 500 euros. Elle voit bien que ce qu’elle a accompli pour changer le pays n’est pas du tout reconnu. » L’historien Marcus Böick compare la Treuhand à un « zombie mémoriel » qui cristallise toutes les « créances pourries » de l’unification allemande : l’anéantissement industriel, le dépeuplement des régions, les inégalités, le chômage de masse dans un pays où, plus encore qu’ailleurs, le travail fondait le statut social. Die Linke réclame une nouvelle commission d’enquête parlementaire qui accéderait aux documents mis au secret en 1990. Tous les autres partis du Bundestag s’y opposent, à l’exception de l’AfD. Pour dépouiller les 45 kilomètres de dossiers, les 7 archivistes récemment embauchés jalouseront peut-être les 1 400 employés dévolus aux papiers de la Stasi…
En attendant leurs conclusions, on peut déjà tirer deux bilans de l’annexion de la RDA. Du premier, les dirigeants allemands peuvent se féliciter : dans les années 1990, leur pays regagne sa position centrale ; l’Union européenne accélère son intégration politique et monétaire selon les principes de la rigueur germanique — fruit tardif du traité d’unification allemand, le traité de Maastricht coûtera des millions de chômeurs à l’Europe. L’autre bilan porte la couleur de la désillusion. En échange des libertés politiques et du développement des infrastructures, la population est-allemande fut jetée dans les flots du capitalisme avec une pierre autour du cou. « Le paradoxe de l’unification, observera en 1998 l’ancien opposant à l’État-parti Edelbert Richter, c’est que les Allemands de l’Est ont été intégrés dans la démocratie et l’économie sociale de marché en même temps qu’ils étaient en grande partie exclus de ce qui en constitue la base essentielle, à savoir le travail et la propriété (20). »
Naguère industrielle et exportatrice, l’économie de l’ex-RDA dépend désormais de la demande intérieure et des aides sociales octroyées par l’État fédéral. Pour le patronat, l’annexion a enclenché un cercle vertueux : les transferts publics vers les nouveaux Länder financent des biens et des services produits par des entreprises de l’Ouest et se métamorphosent en profits. « En vérité, a admis en 1996 l’ancien maire de Hambourg Henning Voscherau (SPD), les cinq années de “construction de l’Est” (21) ont représenté le plus grand programme d’enrichissement des Allemands de l’Ouest jamais mis en œuvre. » C’est aussi cela que commémore, chaque 9 novembre, la classe possédante occidentale.
Rachel Knaebel & Pierre Rimbert
Journaliste, Berlin.
(1) Formulée par le chancelier Helmut Kohl en 1990.
(2) Cité par Sonia Combe, La Loyauté à tout prix. Les floués du « socialisme réel », Le Bord de l’eau, Lormont, 2019.
(3) Cité par Ralph Hartmann, Die Liquidatoren. Der Reichskommissar und das wiedergewonnene Vaterland, Edition Ost, Berlin, 2008.
(4) Wolfgang Schäuble, Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einheit verhandelte, DVA, Stuttgart, 1991.
(5) Vladimiro Giacché, Le Second Anschluss. L’annexion de la RDA, éditions Delga, Paris, 2015.
(6) Thilo Sarrazin, « Die Entstehung und Umsetzung des Konzepts der deutschen Wirtschafts- und Währungsunion », dans Theo Waigel et Manfred Schell, Tage, die Deutschland und die Welt veränderten, Ferenczi bei Bruckmann, Munich, 1994.
(7) Christa Luft, Zwischen WEnde und Ende, Aufbau, Berlin, 1991.
(8) Cité par Vladimiro Giacché, Le Second Anschluss, op. cit.
(9) Richard Schröder, Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit, Herder, Fribourg-en-Brisgau, 2007.
(10) Der Spiegel, Hambourg, 19 décembre 1994. Compte tenu de l’inflation, 1 000 marks de 1990 équivalent à environ 300 euros d’aujourd’hui.
(11) Marcus Böick, Die Treuhand. Idee-Praxis-Erfahrung, 1990-1994, Wallstein Verlag, Göttingen, 2018.
(12) Wolfgang Dümcke et Fritz Vilmar (sous la dir. de), Kolonialisierung der DDR. Kritische Analysen und Alternativen des Einigungsprozesses, Agenda Verlag, Münster, 1996.
(13) Marcus Böick, Die Treuhand, op. cit.
(14) Ibid.
(15) « Beschlußempfehlung und Bericht des 2. Untersuchungsausschusses “Treuhandanstalt” » (PDF), Bundestag, Berlin, 1994.
(16) Die Welt, Berlin, 2 octobre 2010.
(17) Ralph Hartmann, Die Liquidatoren, op. cit.
(18) Cité par Marcus Böick, Die Treuhand, op. cit.
(19) Dirk Laabs, Der Deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand, Pantheon Verlag, Munich, 2012.
(20) Cité par Fritz Vilmar et Gislaine Guittard, La Face cachée de l’unification allemande, L’Atelier, Paris, 1999.
(21) Cité par Vladimiro Giacché, Le Second Anschluss, op. cit. La « construction de l’Est » (Aufbau Ost) désigne le programme de financement des nouveaux Länder. |
| |  Un autre article du Monde Diplo de novembre sur la réunification Un autre article du Monde Diplo de novembre sur la réunification
L’Allemagne, puissance sans désir
Ce qu’ont perdu les femmes de l’Est
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/05/KERGEL/52925
Vingt-cinq ans après, la vie quotidienne des Allemandes reste très marquée par les conceptions différentes de leur rôle qui régnaient des deux côtés du Mur.
par Sabine Kergel
A la faveur du processus d’unification, la plupart des sociologues avaient parié que les conditions de vie des femmes à l’Est et à l’Ouest s’harmoniseraient à court ou moyen terme. Pronostic trop optimiste ? En 2007, par exemple, seules 16 % des mères d’enfants âgés de 3 à 5 ans occupaient un emploi à temps plein dans l’ouest du pays, contre 52 % à l’Est. Et, si le taux de natalité de l’ancienne République démocratique allemande (RDA) est désormais aussi bas que celui de l’Ouest, de fortes disparités subsistent (1). Ainsi du pourcentage de naissances hors mariage : 61 % dans la partie orientale en 2009, contre 26 % dans la partie occidentale (2).
La population féminine des nouveaux Länder a été particulièrement affectée par les bouleversements sociaux et politiques provoqués par l’unification. En RDA, les mères, contrairement à celles de la République fédérale d’Allemagne (RFA), conciliaient sans embarras vie familiale et vie professionnelle. L’absorption de l’Est par l’Ouest a provoqué une hausse vertigineuse de leur taux de chômage et chamboulé leurs modes de vie, leurs projets, leur confiance en elles.
Dans toute l’Allemagne, comme ailleurs en Europe, le taux d’activité des femmes s’est considérablement accru depuis les années 1950, mais en RDA cette évolution a été sans commune mesure avec celle de l’Ouest. A la fin des années 1980, 92 % des Allemandes de l’Est occupaient un emploi, contre 60 % de leurs voisines occidentales. Sur ce point, l’égalité était en vue — un cas presque unique au monde. Alors qu’à l’Ouest les femmes orientaient leurs projets de vie selon des schémas encore très imprégnés par l’imagerie familiale et patriarcale traditionnelle, à l’Est, leur indépendance économique vis-à-vis du conjoint allait pour ainsi dire de soi.
La chute spectaculaire de la natalité observée en RDA au cours des années 1970 a conduit le régime à prendre diverses mesures pour inciter les femmes actives à enfanter, avec un effort particulier en faveur des mères isolées ou divorcées. Parfois moquée pour sa justification idéologique (alimenter en effectifs la construction d’une « société socialiste » ), cette politique a cependant permis d’harmoniser projets professionnels et contraintes parentales. De l’autre côté du Mur, en revanche, la condition de mère entraînait souvent des privations, voire un basculement dans la pauvreté, surtout en cas de divorce ou d’abandon par le conjoint.
Rien d’étonnant donc à ce que les femmes de l’ex-RDA aient souvent perçu la réunification comme une menace pour leurs conditions de vie. A travers l’expérience inédite du chômage, c’est un système de valeurs apparaissant jusque-là comme évident qui s’est effondré. « A l’agence pour l’emploi, quand tu leur dis “seule avec deux enfants”, ils ne savent pas de quoi tu parles. L’agente assise en face de moi ne m’a même pas jeté un regard, rien, raconte Ilona, mère isolée et ancienne vendeuse à Berlin-Est. Elle remplit sa fiche, vite, et puis dehors, au suivant. » En RDA, les femmes vivaient sous la protection d’un Etat omnipotent qui maintenait le père et la famille dans une fonction sociale subalterne. Opérée sous l’égide des institutions, la socialisation des enfants eux-mêmes était largement déconnectée de la cellule familiale. Or l’attachement féminin à l’autonomie n’a pas disparu avec le Mur.
Une enquête menée auprès de Berlinoises sans emploi au début des années 2000 révélait des rapports très différents au travail et aux enfants. Toutes considéraient ces derniers comme un élément central de leur existence, mais celles qui venaient de l’Ouest leur accordaient plus d’importance qu’à leur travail. Bien que conscientes des tracas qui les guettaient, elles avaient tendance à voir leur chômage comme une occasion de jouer pleinement leur rôle auprès d’eux. En revanche, les Berlinoises de l’Est voulaient mener de front leur éducation et la réalisation de leurs projets professionnels, estimant qu’ils grandiraient dans de meilleures conditions si elles retrouvaient un emploi. « Mieux dans leur peau » en tant que travailleuses, elles seraient mieux à même de jouer leur rôle de mères. Elles considéraient leur indépendance comme un bienfait pour elles et pour leur famille.
Une protection sociale fiable, condition essentielle de l’égalité des droits
Les mères de Berlin-Ouest estimaient en général que personne n’était mieux placé qu’elles pour prendre soin de leurs enfants. Tout en reconnaissant l’utilité des crèches et des haltes-garderies, elles tendaient à s’accommoder de leurs horaires très stricts. Pour les mères de Berlin-Est, en revanche, habituées aux horaires plus souples de la RDA, l’accès aux crèches représentait un enjeu crucial, d’autant plus que les employeurs en tenaient compte dans leur politique d’embauche. En 2000, Anna, vendeuse au chômage de 28 ans, ne cachait pas sa colère devant les refus en rafale qu’elle essuie au seul motif de sa condition de mère isolée. « On te répète tout le temps : “Quoi, vous avez deux gosses ? Ah, mais ça ne va pas être possible.” Quand je leur explique que j’ai trouvé un arrangement pour les faire garder, ils font la sourde oreille. » S’y ajoute l’éternel soupçon qu’elle pourrait enfanter à nouveau : « Il y a pourtant peu de chances que je retombe enceinte. C’est ce que j’ai dit à un type récemment : je ne vais pas refaire un enfant alors que j’en ai déjà deux, ne vous inquiétez pas. » Du temps de la RDA, pareille proclamation au bureau d’embauche eût été inconcevable.
Les mères de Berlin-Ouest voient le chômage comme une chance
Toutes les mères de l’Est en recherche d’emploi ont ainsi dû montrer patte blanche, convaincre qu’elles maîtrisaient les nouvelles règles du jeu, tout en supportant l’humiliation de se voir infliger un tel traitement. Pour les Berlinoises de l’Ouest, en revanche, ce sont surtout les exigences croissantes du marché du travail qui posent problème. Paula, mère isolée de 36 ans et secrétaire au chômage, avait postulé pour un emploi à deux pas de chez elle. « Cela aurait été parfait : on me demandait de taper à la machine, de passer des coups de téléphone, de m’occuper des clients, etc. Et puis la directrice m’a dit : “Bon, il se peut que parfois on vous demande de travailler plus de quarante heures ou de venir le week-end.” J’ai répondu que cela ne m’arrangeait pas du tout, que j’aimais mieux travailler trente heures, comme dans mes boulots précédents. Qu’est-ce que je n’avais pas dit là ! Elle s’est mise à me crier dessus, elle était hors d’elle. Avec tout le chômage qu’il y a, me disait-elle, je devais m’estimer heureuse de trouver un travail. Puis elle m’a demandé quel effet cela faisait d’être une assistée, une parasite qui vivait aux frais de la société. » Et Paula de s’interroger : « Moi, je ne demande pas mieux que de travailler, mais c’est quoi cette société où il faut donner ses enfants à garder de l’aube jusqu’au soir ? »
Selon les sociologues Jutta Gysi et Dagmar Meyer, « le résultat le plus positif de la politique familiale menée en RDA tenait à l’indépendance économique acquise par les femmes. C’est quelque chose d’inimaginable aujourd’hui. Certes, elles touchaient un salaire inférieur de 30 % en moyenne à celui des hommes, car elles étaient souvent affectées à des postes moins qualifiés, et en ce sens leur condition n’avait rien de reluisant, ce que l’on a parfois tendance à oublier. Mais elles ne connaissaient pas la peur de perdre leur logement ou de ne pas trouver de place en crèche, car elles pouvaient s’appuyer sur une protection sociale solide et fiable. C’est une condition importante de l’égalité des droits, peut-être même la condition essentielle (3) » .
Avec un tel héritage, Edeltraud, cuisinière de 28 ans, mariée et mère de deux enfants, vivait très mal, dix ans après la chute du Mur, son assujettissement aux lois sociales actuelles et à son mari. « On devient dépendante de son partenaire, dépendante de l’argent qu’il veut bien nous donner, dépendante de la façon dont l’Etat évalue tout ça. S’il décide de vous sucrer vos allocations, c’est comme ça, point barre. Vous vous retrouvez là avec votre mal de tête, parce que l’argent, ce satané argent, c’est un sujet qui revient tout le temps, on n’y peut rien. »
Le modèle est-allemand de l’égalité hommes-femmes a eu beau s’effondrer avec le Mur, il continue, un quart de siècle plus tard, de façonner la représentation que les mères de l’ex-RDA se font d’elles-mêmes et de leur rôle social.
Sabine Kergel
Sociologue, chercheuse à l’Université libre de Berlin.
(1) Lire Michel Verrier, « Une “panne démographique” qui vient de loin », Le Monde diplomatique, septembre 2005.
(2) Joshua Goldstein, Michaela Kreyenfeld, Johannes Huinink, Dierk Konietzka et Heike Trappe, « Familie und Partnerschaft in Ost- und Westdeutschland », Institut Max-Planck de recherches démographiques, Rostock, 2010.
(3) Jutta Gysi et Dagmar Meyer, « Leitbild : berufstätige Mütter — DDR-Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe », dans Gisela Helwig et Hildegard Maria Nickel, Frauen in Deutschland 1945-1992, Akademie Verlag, Berlin, 1993. |
| |  Les retrouvailles de 1989 ont retardé la crise - https://www.monde-diplomatique.fr/1997/04/ROWELL/4674 Les retrouvailles de 1989 ont retardé la crise - https://www.monde-diplomatique.fr/1997/04/ROWELL/4674
Qui a profité de l’unification allemande ?
« Ce nouveau gouvernement est devenu nécessaire parce que l’ancien a démontré son incapacité à combattre le chômage, à défendre le filet de sécurité sociale et à rétablir l’ordre dans les finances ruinées de l’Etat » . Dressé en 1982 par M. Helmut Kohl contre son prédécesseur, M. Helmut Schmidt, ce réquisitoire s’applique mot pour mot, quinze ans plus tard, à l’actuelle coalition. La contestation sociale s’affirme avec, en mars 1997, les mouvements revendicatifs des mineurs et des ouvriers du bâtiment et commence à s’exprimer politiquement. La question de l’unification, de ses victimes et de ses profiteurs, retrouve ainsi une singulière actualité.
par Jay Rowell
C’est avec beaucoup d’émotion et quelque nostalgie que Helmut Kohl doit repenser aujourd’hui aux jours heureux de l’unification allemande, qui virent son triomphe. Sur fond de crise économique, de montée du chômage, de remise en question des acquis sociaux et de peur de l’euro, la cote du chancelier comme celle de son parti sont tombées au plus bas : selon les sondages du début mars 1997, 46 % des Allemands déclarent préférer le social-démocrate Schröder, 40 % demeurant favorables à l’actuel chef du gouvernement ; de même, avec 34,3 %, les démocrates-chrétiens de la CDU-CSU sont devancés par les sociaux-démocrates du SPD (36,3 %). Egalement significatives, les intentions de vote en faveur des Verts (12,2 %) et du Parti du socialisme démocratique (5,2 %), en nette progression. Paradoxalement, l’homme qui a dû son indiscutable popularité aux retrouvailles — dont il fut le principal artisan — des deux Allemagnes laisse aujourd’hui entendre que l’unification serait la cause des difficultés rencontrées par son pays, et de ses propres déboires !
L’Allemagne malade de l’unification ? Celle-ci aurait eu — assure une majorité d’experts — un effet de frein sur l’économie prospère de l’ancienne RFA. Et de citer les transferts financiers de l’Ouest vers l’Est, qui se sont effectivement élevés, depuis 1990, à plus de 150 milliards de marks (1 mark = 3,4 francs) par an et devraient se maintenir à ce niveau dans les prochaines années. A quoi s’ajoutent les dettes laissées par l’ex-RDA, la Treuhand (l’organisme chargé de privatiser l’économie de la RDA) et les fonds spéciaux de l’unification, soit 750 milliards de marks — une somme colossale, surtout si on la rapporte au produit intérieur brut (PIB) actuel des nouveaux Länder (250 milliards de marks).
Cet argumentaire, si souvent répété, occulte toutefois la moitié de l’équation : car l’unification n’a pas seulement coûté à l’ex-RFA, elle lui a également rapporté. Et beaucoup ! Un symbole, évidemment peu souligné par les médias : les profits des entreprises allemandes ont presque doublé depuis l’unification, passant de 345 milliards de marks en moyenne entre 1980 et 1989 à 653 milliards en 1995 ! Victimes d’un côté, profiteurs de l’autre...
En tout cas, les doutes quant au modèle économique allemand n’ont jamais été aussi forts (1). En janvier 1997, le taux de chômage s’est élevé à 18,7 dans les nouveaux Länder et à 10,7 % dans les anciens. Selon les prévisions, la barre des 5 millions de chômeurs sera dépassée avant la fin de l’année. A l’Est, le PIB est tombé au-dessous de son niveau de 1989, avant la « thérapie de choc ». A l’Ouest, la récession apparue en 1993 a été aggravée par les tours de vis fiscaux et les plans d’austérité.
Que s’est-il passé depuis 1990, époque d’euphorie et de confiance aveugle dans les recettes néolibérales ? Apparemment, les Allemands de l’Ouest auraient payé la facture de l’unification. Et ils seraient condamnés à sacrifier encore longtemps une partie de leur richesse pour payer une « rente » annuelle à leurs concitoyens des nouveaux Länder. Curieux renversement : car ceux qui subissent, les premiers et le plus durement, l’unification, ce sont bien les Allemands de l’Est. Un an après les retrouvailles, le PIB de l’ex-RDA avait déjà chuté de 40 %, la production industrielle de 70 %, et le nombre d’actifs de 40 %. A cette catastrophe quatre causes principales :
— la décision électoraliste d’échanger un mark de l’Est contre un mark de l’Ouest, qui a augmenté le coût réel des biens et services est-allemands de 300 %. Ce choc, confie M. Werner Selbmann, chef d’une petite entreprise de bâtiment en Thuringe, aurait été « mortel même pour les géants de l’industrie ouest-allemande » ;
— la réduction comme peau de chagrin des débouchés traditionnels de l’industrie est-allemande dans les pays de l’Europe centrale, suite aux politiques d’ajustement des équipes néolibérales, dont l’économiste Jeffrey Sachs est la figure de proue ;
— le fait que l’industrie ouest-allemande pouvait satisfaire les besoins du marché est-allemand avec ses capacités existantes, les entreprises est-allemandes ne représentant alors au mieux, pour elle, qu’un moyen de pénétrer les marchés d’Europe centrale, au pis une concurrence potentielle sur le marché allemand ;
— la thérapie de choc subie par les Kombinate est-allemands, mis sous la tutelle de la Treuhand (lire « Un formidable transfert de propriété ») : démantèlement ou fermeture avec vagues de licenciements, selon le credo libéral de la Treuhand. D’où la priorité absolue donnée à la privatisation rapide au détriment de l’emploi et de l’investissement. La vente des entreprises, qui devait dégager, selon le premier directeur de la Treuhand, 600 milliards de marks, s’est soldée par un déficit de 275 milliards de marks, une perte de 78 % des emplois dans le secteur industriel ; seules 5 % des entreprises ont pu être achetées par des Allemands de l’Est.
Au local syndical de l’IG Metall, situé au cœur de Plagwitz, un quartier ouvrier de Leipzig où les immeubles d’habitation côtoient les usines désaffectées, Mme Sieglinde Merbitz, premier secrétaire du syndicat à Leipzig, explique : « Ce sont les femmes, les salariés de plus de cinquante ans et les ouvriers peu qualifiés qui ont été victimes des premières vagues de licenciements dans la métallurgie. Pour eux, la chance de retrouver un emploi est quasiment nulle. » Bref, tous ceux qui n’ont pu s’adapter à l’économie de marché ou que l’on décréta inaptes à le faire. Quand les statistiques officielles n’enregistrent « que » 18,7 % de chômeurs dans les nouveaux Länder, dont deux tiers de femmes, elles « oublient » 800 000 salariés en préretraite, 260 000 participants à des stages de recyclage et 260 000 personnes qui travaillent dans des programmes d’intérêt général appelés à disparaître cette année, à la su réductions budgétaires imposées pour que l’Allemagne respecte les critères du traité de Maastricht.
Ingénieur de quarante-cinq ans et mère célibataire, Mme Hilde Förster vit une situation emblématique du parcours de beaucoup de femmes est-allemandes. Employée dans la recherche-développement du VEB Nachrichtenelektronik, elle a perdu son travail peu de temps après que cette entreprise de 4 000 employés eut été achetée par le géant ouest-allemand Siemens. La recherche-développement était alors considérée comme superflue, et seulement 600 emplois ont pu être maintenus. Après deux ans de travail d’intérêt général, elle s’est trouvée au chômage : « Le plus dur, c’est de se sentir inutile, de se rendre compte que la société n’a plus besoin de toi... que tu es déjà trop vieille. » 88 % des Allemands de l’Est estiment qu’il y avait plus d’égalité entre les sexes en RDA qu’en RFA — 2 % pensent l’inverse (2).
De l’autre côté, les choses se sont passées autrement... du moins jusqu’en 1992. A la déprime et au sentiment de trahison répandus à l’Est a correspondu, à l’Ouest, l’euphorie générée par les usines tournant à plein régime. Alors que le reste de l’Europe sombrait dans la récession dès 1990, et que l’économie est-allemande implosait, le PIB ouest-allemand augmentait de 5,7 % en 1990 et de 4,5 % en 1991, avec une création nette de 1,8 million d’emplois.
L’explication est simple. Les biens et services ouest-allemands se sont purement et simplement substitués aux produits est-allemands. L’excédent commercial intranational s’élève à plus de 200 milliards de marks par an, ce qui compense largement les 150 milliards de fonds publics qui vont dans le sens inverse (3). Selon M. Andreas Körner, conseiller municipal (SPD) à Leipzig, « l’argent transféré a été en fait recyclé à 100 % dans l’économie ouest-allemande. C’est grâce à la reconstruction de l’économie est-allemande que l’Allemagne n’a pas sombré dans la récession dès 1990 comme les autres pays industrialisés. » Résultat paradoxal d’une politique néolibérale, la thérapie de choc a abouti à une relance keynésienne classique au seul bénéfice de l’économie ouest-allemande.
Les salariés ouest-allemands en ont-ils profité ? Rien n’est moins sûr. Dès les premiers signes de ralentissement économique, le patronat a annoncé des restructurations douloureuses entraînant la perte de centaines de milliers d’emplois dans l’industrie. En 1992, l’augmentation de 5 % des salaires a été absorbée totalement par l’inflation (plus de 4 %) et par l’alourdissement de la fiscalité — entre 1991 et 1993, les cotisations pour l’assurance-chômage ont augmenté de 2 points, les taxes sur les produits pétroliers et le tabac ont été relevées, la TVA a augmenté de 1 point, sans oublier l’introduction du très impopulaire impôt de solidarité (Solidäritatszuschlag), qui a représenté une hausse de 7,5 % de l’impôt sur le revenu. En moyenne, ces mesures ont signifié une amputation du pouvoir d’achat de 270 marks par ménage (4), un recul de 5 % depuis 1990.
Ces salariés, victimes à l’Est et à l’Ouest
La crise économique et l’austérité budgétaire aidant, les salariés de l’Ouest s’en sont pris aux citoyens des nouveaux Länder, accusés de vivre à leurs dépens. Il est vrai que le gouvernement a justifié l’augmentation de la pression fiscale par la nécessité de sacrifices en faveur de la solidarité avec les Allemands de l’Est. Et l’addition, de fait, a été douloureuse pour les salariés ouest-allemands. Mais les gens de l’Est ont également payé l’impôt de solidarité, comme tous les autres impôts, directs ou indirects. « Le mythe des citoyens est-allemands qui ne paient pas l’impôt de solidarité a été savamment entretenu. Comment s’étonner alors que le mur qui existe dans les esprits ne soit pas près de disparaître ? » , constate avec un brin d’amertume M. Andreas Körner.
La vérité, c’est qu’à l’Ouest comme à l’Est ce sont les salariés qui font les frais de l’unification. Ce qui n’empêche pas la Bundesbank, dans son rapport de 1995, de persister à considérer « les salaires trop élevés et insuffisamment différenciés » comme le facteur principal de la dégradation de la compétitivité. Et de passer sous silence le faible taux d’investissement, les taux d’intérêt prohibitifs et la surévaluation du mark, qui pénalisent une économie dépendant des exportations (5).
La facture la plus lourde a été acquittée par les chômeurs, plus généralement tous ceux qui dépendent de l’assistance publique, et par les étrangers. Telles sont, paradoxalement, les victimes du prétendu pacte de solidarité de 1993 : sous couvert de mieux répartir les coûts de l’unification, le gouvernement de M. Helmut Kohl s’est alors attaqué à l’Etat-providence. Cette année-là marque le début des plans d’austérité, donc de la réduction, constante depuis, des allocations de chômage et des aides sociales comme familiales, ainsi que de la diminution des remboursements des caisses d’assurance-maladie. Quant aux retraites, elles stagnent alors que l’âge légal a été repoussé à soixante-cinq ans ; en vertu du projet de réforme fiscale, les impôts qui les frappent vont même être augmentés. Contradictoirement, les plans sociaux mettent les salariés en préretraite dès cinquante-deux ans. De surcroît, 1997 sera l’année de la remise en question de la gratuité de l’enseignement supérieur...
Présentés par certains hommes politiques et par la presse de boulevard comme des « nantis » , les demandeurs d’asile sont de plus en plus attaqués — mais ces campagnes épargnent les entrepreneurs qui réalisent des profits scandaleux en les hébergeant. Ainsi la firme GV Gründstücksverwaltung a-t-elle entassé 300 demandeurs d’asile dans 75 baraques de chantier et encaissé mensuellement 137 000 marks de loyer — soit 1 860 marks par baraque de 14 m2 (6). Le droit d’asile ayant été restreint en 1993 sous couvert d’harmonisation européenne, c’est maintenant au tour des travailleurs immigrés de servir de cible. Des voix influentes de l’aile droite de la majorité trouvent « aberrant » qu’un pays ayant autant de chômeurs emploie des étrangers.
Sous prétexte de combattre les « fraudeurs » , les « tire-au-flanc » et les « faux demandeurs d’asile » , on dresse les classes moyennes, écrasées sous le poids du fisc, contre les laissés-pour-compte du marché. M. Joachim Widmann (du Parti libéral) a même lancé l’idée d’imposer les « revenus » des mendiants, afin de réduire le déficit budgétaire et de « résoudre rapidement le problème de la mendicité dans les villes (7) » .
L’augmentation spectaculaire du chômage — d’abord dans les nouveaux Länder (de 3 % en 1990 à près de 19 % début 1997), puis dans les anciens (de 6,9 % en 1990 à près de 11 % début 1997) — a modifié les rapports de forces entre les syndicats et le patronat en faveur de ce dernier. Plus rien n’est tabou, comme en témoigne la déclaration de M. Werner Stumpfe, président du syndicat patronal de la métallurgie : « Nous avons payé trop cher la paix sociale. Nous ne pouvons plus continuer à nous offrir un tel luxe (8). »
Pareille déclaration de guerre aurait été impensable il y a quelques années. Ce qui l’a rendue possible, c’est l’exploitation de la crise à l’Est. Le premier tabou fut brisé en 1993, lorsque le patronat revint sur l’accord signé en 1990 et garantissant la convergence progressive des salaires est-allemands sur le niveau ouest-allemand. Depuis, de nombreuses entreprises se sont unilatéralement retirées des conventions collectives, comme Jenoptik et IBM. Bref, le patronat s’efforce d’instrumentaliser la crise à l’Est pour généraliser, à l’Ouest aussi, la remise en question des deux piliers du compromis historique de l’Allemagne : le droit du travail et la négociation salariale.
Dans les nouveaux Länder, il est vrai, la pression psychologique exercée par le taux record de chômage contraint les salariés à accepter des sacrifices pour conserver leur travail et met les syndicats sur la défensive. Le maintien des postes se négocie à n’importe quel prix, ou presque — une attitude compréhensible de la part des travailleurs menacés, mais que le patronat exploite par un véritable chantage à l’emploi. En échange de ses investissements dans les nouveaux Länder, le patronat exige de très fortes subventions. Et, quand les travailleurs prétendent défendre leurs intérêts, il brandit la menace de délocalisation dans les pays de l’Est, où les salaires sont jusqu’à dix fois inférieurs.
Pourtant, la ruée annoncée sur l’Europe centrale n’a pas eu lieu. En 1992, celle-ci n’a attiré que 6,5 % des investissements directs de l’Allemagne à l’étranger, contre 89 % dans les pays industrialisés, notamment les Etats-Unis (9). Les grandes entreprises n’en poursuivent pas moins leur chantage à la délocalisation et, arguant du coût excessif de la main-d’œuvre est-allemande, obtiennent de nouvelles subventions et déductions, au-delà des 50 % déjà consentis à l’investissement dans les nouveaux Länder. Le projet d’usine Volkswagen à Chemnitz, en Saxe, devait rapporter à la firme des subventions de l’ordre de 500 000 marks par emploi créé... jusqu’à ce que la Commission européenne mette son veto pour concurrence déloyale.
Si les puissants Konzerne s’engraissent sur les deniers publics, ce sont les petites et moyennes entreprises qui représentent l’avenir de l’emploi dans les nouveaux Länder. Mais, faute d’un lobby en leur faveur dans le gouvernement fédéral, elles étouffent sous la pression de leurs créditeurs.
Les aventures de l’entreprise de bâtiment dirigée par M. Werner Selbmann sont, à bien des égards, emblématiques. Nous recevant à son domicile dans le village de Heyerode, en Thuringe, il raconte : « Notre société avait été vendue par la Treuhand aux anciens directeurs pour 24 millions de marks — un achat entièrement financé par l’emprunt. (…) L’Est a attiré beaucoup d’investisseurs disons “peu sérieux”, des Allemands de l’Ouest qui voulaient faire fortune. Il a suffi de quelques factures impayées pour provoquer des faillites en chaîne dans l’industrie du bâtiment. Aujourd’hui, je me retrouve en concurrence avec des entreprises étrangères, qui utilisent de la main-d’œuvre portugaise, polonaise ou anglaise payée à 5 marks de l’heure. »
Certes, les syndicats ont réussi à tenir en échec les projets les plus rétrogrades du gouvernement et du patronat, grâce à plusieurs fortes mobilisations. Il n’empêche : les entreprises ouest-allemandes apparaissent clairement comme les grands gagnants de l’unification. Dans les années fastes, de 1990 à 1992, elles ont engrangé des profits spectaculaires, grâce notamment aux nouveaux Länder dont la production locale s’était effondrée. En 1993, malgré une forte récession, leurs bénéfices ont dépassé 500 milliards de marks, pour atteindre en 1995 un record historique : 653 milliards !
Malheureusement, les statistiques catastrophiques du chômage le confirment, les profits d’hier n’ont pas fait les emplois d’aujourd’hui. Et rien n’indique que cela changera demain. Pourtant, sous prétexte de sauvegarder la production nationale, le gouvernement a fait adopter en 1994, sous le nom de Standortsicherungsgesetz, une loi réduisant de 53 % à 44 % les impôts sur les sociétés — et de nouveaux allègements sont annoncés pour 1999. Or ces impôts bénéficient de tant de déductions que leur taux effectif plafonne à 15 %, soit deux fois moins qu’aux Etats-Unis ou en France (10). Au total, en 1995, les entreprises allemandes ont réglé 19,5 milliards de marks d’impôt sur les sociétés, un chiffre à comparer aux 136 milliards de marks d’exonérations d’impôts et de subventions, mais aussi aux 284 milliards de marks produits par l’impôt sur les revenus…
N’oublions pas les profits fantastiques réalisés par les grandes banques grâce aux décisions prises en 1990 : des dizaines de milliards de marks, sans le moindre risque. Un seul exemple : la Deutsche Bank et la Dresdner Bank ont acheté la Deutsche Kreditbank, la plus grande banque de la RDA, pour 20 milliards de marks, en 1990 — cette opération leur a rapporté, depuis, 60 milliards ! L’astuce était simple : l’épargne a été échangée à un 1,475 mark-est contre 1 mark, mais les créances à 2 contre 1. La différence — soit 92 milliards de marks — a été comblée par le gouvernement fédéral, qui verse chaque année des intérêts de plus de 10 milliards aux banques concernées (11). Rien d’étonnant si la Deutsche Bank affiche des profits en hausse de 77 % entre 1990 et 1993 !
Et il n’y a pas que les banques : globalement, entre 1990 et 1995, les revenus du capital ont augmenté de 19,4 %, ceux du travail diminué de 5 %. C’est là l’effet conjugué des taux d’intérêt extrêmement élevés du début des années 90, de flambée de la Bourse et de la très faible imposition des revenus du capital. Une première tentative de taxer ceux-ci, en 1987, a buté sur une fuite massive de capitaux. Une deuxième tentative, en 1993, devait éliminer ce risque en taxant le capital à la source. Mais, entre-temps, le plafond a été multiplié par dix, et les banques elle-mêmes ont organisé le transfert des capitaux vers leurs filiales au Luxembourg et d’autres paradis fiscaux.
Simultanément, les déductions d’impôts avaient atteint 50 % sur les investissements immobiliers dans les nouveaux Länder. « Elles ont provoqué, explique Mme Anke Matejka, présidente de l’Association des locataires de Leipzig, une flambée de spéculation sur les appartements de standing, où les loyers ont quelquefois dépassé le niveau ouest-allemand. » Nous recevant à son siège, entouré de bureaux neufs et... vides, Mme Matejka ajoute : « Ce sont les grands groupes immobiliers ouest-allemands qui ont raflé la mise. » Le pouvoir d’achat ayant stagné à 60 % du niveau ouest-allemand, même les « privilégiés » détenteurs d’un emploi ne parviennent pas à payer leur loyer.
C’est dire que l’image d’une société de « classes moyennes nivelées » , popularisée par le sociologue Herbert Schelsky dans les années 60, fait figure d’utopie dans l’Allemagne unifiée : les 10 % les plus riches de la population allemande concentrent 49 % du patrimoine, tandis que les 50 % d’en bas n’en détiennent que 2 %. D’ailleurs, le 5 septembre 1996, le ministre des finances, M. Theo Waigel, suggérait d’abolir l’impôt sur la fortune... Si l’immense majorité de la fortune se concentre à l’Ouest et une grande partie de la nouvelle misère à l’Est, c’est avant tout un clivage vertical qui marquera l’Allemagne de demain.
Mais, s’agissant des comptes de l’unification, on ne saurait se limiter à l’Allemagne. En fait, l’équilibre économique de l’Europe tout entière a été bouleversé par l’événement. L’endettement de la RFA et les tensions inflationnistes de 1989-1992 ont conduit la Bundesbank à relever ses taux directeurs de 6 % à près de 10 %, ce qui a pesé lourdement et durablement sur une conjoncture économique déjà morose dans le reste du continent.
La politique restrictive de la Bundesbank et le recours massif à l’emprunt par le gouvernement allemand ont indirectement fait payer l’unification aux partenaires de Bonn : par le biais des taux d’intérêt et de la hausse consécutive du nombre de chômeurs. Ainsi la Bundesbank et le gouvernement ont-ils fait passer leurs intérêts avant ceux de leurs partenaires européens, alors que l’encre des signatures au bas du traité de Maastricht était à peine sèche.
Enterrement dogmatique
Lors des négociations préparatoires, les dirigeants de l’Allemagne unifiée surent utiliser habilement les peurs suscitées par leur nouvelle puissance pour imposer leur modèle de politique monétaire. Dans un premier temps, le traité avait stipulé l’indépendance des banques centrales, en attendant la création de la Banque centrale européenne chargée d’assurer la stabilité de la monnaie unique. Cet entêtement dogmatique a sans doute coûté des millions d’emplois à l’Europe, alors qu’aux Etats-Unis la Réserve fédérale a depuis longtemps renoncé à l’orthodoxie monétariste, avec les résultats (relatifs) que l’on sait en matière de croissance.
Les discours lénifiants sur l’adoption du « pacte de stabilité » — entériné à Dublin, en décembre 1996, largement sous la pression de Bonn — augurent mal de l’avenir économique de l’Europe. Si l’Allemagne prétend réduire le plus possible le premier wagon de l’euro, tentant notamment d’en exclure les pays du sud de l’Union européenne, elle ne donne pourtant nullement l’exemple. Son endettement public a dérapé, dépassant 80 % du PIB, et son déficit budgétaire dépasse la fameuse barre des 3 % du PIB depuis 1990 (12). Quant à son taux de chômage, il rivalise dorénavant avec celui de la France. La seule recette proposée par le chancelier Kohl pour « réduire de moitié le nombre de chômeurs avant l’an 2000 » , c’est une réforme fiscale qui, entrant en vigueur en 1999, devrait favoriser les entreprises et les ménages à haut revenu, parallèlement à l’accélération de la déréglementation et de la privatisation...
La mystification selon laquelle les Allemands de l’Ouest auraient financé l’unification a été propagée à la fois à l’intérieur de l’Allemagne et à l’extérieur. Elle a permis à un gouvernement en échec de masquer — pour un temps — ses erreurs à l’intérieur de l’Allemagne et d’imposer sa « recette » au reste de l’Europe. Cette recette, aux antipodes du modèle de l’économie sociale de marché qui a fondé la réussite économique allemande, s’étendra-t-elle demain sur tout le continent européen ?
Jay Rowell
Chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris.
(1) Lire Matthias Greffrath, « Le modèle allemand bat de l’aile », Le Monde diplomatique, décembre 1996, et Brigitte Pätzold, « Les Allemands de l’Est relèvent la tête », Le Monde diplomatique, février 1996.
(2) Sondage Emnid, dans Der Spiegel, 3 juillet 1995.
(3) Les flux de biens et de services de l’Est vers l’Ouest se sont élevés à 43 milliards de deutschemarks, contre 253 milliards dans le sens inverse en 1994. Lire Rudolf Hickel, Jan Priewe, Nach dem Fehlstart, Fischer Verlag, Francfort-sur- Le Main, 1994. 36 DM.
(4) Selon l’estimation de Rudolf Hickel et Jan Priewe, les augmentations d’impôt ont davantage pesé sur les ménages modestes, amputant 4 % des revenus disponibles des ouvriers et employés contre 1,5 % pour les indépendants ayant des revenus deux fois supérieurs en moyenne.
(5) L’Allemagne a en effet été remplacée par les Etats-Unis à la tête des pays exportateurs, notamment à cause de la réévaluation du mark et de la faiblesse de la conjoncture en Europe.
(6) Dieter Hummel, « Verdienstquelle Flüchtlinge », in Herbert Schui, Eckhart Spoo, dir., Geld ist genug da, Distel Verlag, Heilbronn, 1996. 28 DM.
(7) Joachim Widmann, cité par le Leipziger Volkszeitung, 19 octobre 1996.
(8) Les Echos, 20 mars 1996.
(9) En 1992, les entreprises ouest-allemandes ont investi 42 milliards de deuschemarks dans les nouveaux Länder, contre 1,5 milliard dans les pays d’Europe centrale. Info-Schnelldienst, no 23, 1993.
(10) Lire : Hans-Georg Wehling (dir.), Standort Deutschland, Kohlhammer, Stuttgart, 1994.
(11) Süddeutsche Zeitung du 30 octobre 1995 et Frankfurter Allgemeine Zeitung du 10 novembre 1995.
(12) Fin 1995, la dette se répartit comme suit : 712 milliards de deutschemarks pour l’Etat fédéral, 600 milliards pour les Länder et communes, 275 milliards de deutschemarks pour la Treuhand, et 418 milliards pour les différents fonds créés à l’occasion de l’unification.
Edité le 09-11-2019 à 17:22:25 par Xuan
|
| |  Malgré les efforts des médias pour célébrer la chute du mur de Berlin, le coeur n'y est plus. L'expérience a montré que les peuples n'ont rien gagné à la "liberté" promise mais ont perdu le peu qu'ils avaient. Malgré les efforts des médias pour célébrer la chute du mur de Berlin, le coeur n'y est plus. L'expérience a montré que les peuples n'ont rien gagné à la "liberté" promise mais ont perdu le peu qu'ils avaient.
Parallèlement ce sont les impérialistes US qui construisent des murs, lesquels auront le même sort que celui de Berlin.
Le Monde Diplomatique, en publiant des articles critiques sur la nature de la "réunification" et ses conséquences, a déchaîné l'hystérie de la clique social-démocrate et des anticommunistes de tout poil :
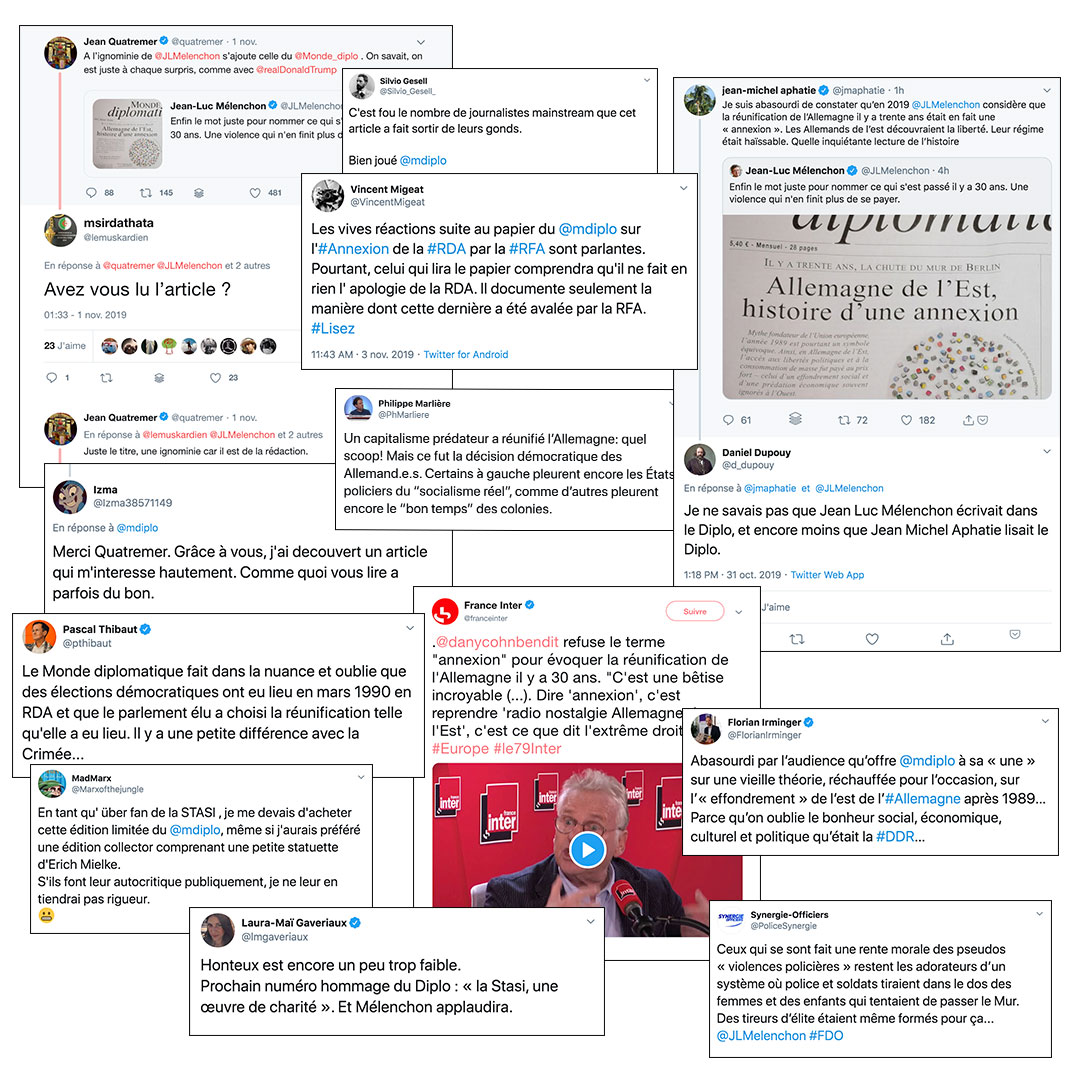
Ces articles seront cités à la suite. Ils montrent que la "réunification" était en fait une opération impérialiste menée par toutes les puissances occidentales avec la collaboration de Gorbatchev.
____________________________________________
Les attaques de Pompeo contre le PCC montrent son hystérie
Source: Global Times Publié le 2019/11/8 22:48:40
http://www.globaltimes.cn/content/1169417.shtml
Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, dans un discours prononcé vendredi à Berlin pour commémorer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, a pris pour cible la Chine et le Parti communiste chinois (PCC). Il a affirmé que le PCC "façonne une nouvelle vision de l'autoritarisme, vision que le monde n'a pas vue depuis très longtemps" . Il disait un gros mensonge. Ces derniers jours, Pompeo a constamment critiqué le PCC, tentant de créer un fossé entre le peuple chinois et le parti au pouvoir. Une telle arrogance politique le rend confus. Ce n'est pas ce que le secrétaire d'État d'un grand pays est censé être.
Le mur de Berlin a non seulement séparé l'Est et l'Ouest de Berlin, mais a également symbolisé l'isolement entre l'Est et l'Ouest à cette époque. La Chine d'aujourd'hui est très ouverte. Nous encourageons la libre circulation des personnes et des biens entre la Chine et les États-Unis conformément aux règles internationalement reconnues. Mais les États-Unis, qui ont préconisé la démolition du mur de Berlin, construisent des murs, des murs tangibles à la frontière américano-mexicaine aux murs invisibles entre la Chine et les États-Unis. Certains Américains sont devenus de moins en moins confiants, jouant des tours plutôt que de rivaliser avec d’autres. Trente ans après la fin de la guerre froide, les élites américaines qui dominent la politique de Washington sont maintenant peu prometteuses.
Pompeo veut créer un fossé entre le Parti, le gouvernement chinois et le peuple, ainsi qu'entre la Chine et le monde. Il est juste de dire que ce que lui-même et certains de ses collègues font est en train de s'aliéner du monde. Les gens savent que les attaques de Pompeo contre la Chine sont motivées par une idéologie et vont à l’encontre de la réalité et du modèle harmonieux formé entre la Chine et le monde.
Le PCC a changé le sort misérable de la Chine qui consiste à être pauvre et faible, à être victime d’intimidation et d’humiliation, transformant ainsi les moyens de subsistance dans le pays. C’est la tâche principale du rajeunissement de la Chine et la plus grande demande de la société. Des gens comme Pompeo utilisent la logique des États-Unis pour rechercher des différences d'intérêts entre le parti au pouvoir et le public en Chine. Ils ne comprennent pas la nature du PCC, mais définissent le parti de 90 millions de membres avec les théories occidentales. Ils ne savent rien de la politique chinoise.
La Chine a maintenu des relations amicales et de coopération avec la grande majorité des pays. Des accusations telles que "piège de la dette" , un terme inventé par les États-Unis, ne peuvent pas brouiller les relations. Il existe des conflits territoriaux entre la Chine et certains pays voisins, mais ils ont bien géré les frictions grâce à des efforts concertés. La Chine n’a pour l’instant pas été confrontée à aucun d’eux. La coopération amicale est le thème de la région Asie-Pacifique.
Pompeo considère que les différences de valeurs sont un outil majeur pour contenir la Chine. Cependant, il n'y a pas de conflit d'intérêts majeur entre la Chine et la plupart des pays occidentaux. Réaliser des intérêts communs par la coopération a pris de l’élan. Les intérêts sont plus importants que l’idéologie dans la définition des relations d’État à État. En tant que secrétaire d'État américain, ne comprend-il pas cela? Il a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis et les pays européens partageaient les mêmes valeurs, exigeant que ces derniers se tiennent aux côtés des États-Unis contre la Chine, la Russie et l'Iran. Comment peut-il soulever de telles demandes égoïstes?
Pompeo a demandé à l'Allemagne de refuser les équipements Huawei et d'abandonner la construction de gazoducs avec la Russie. Les États-Unis ont défini la Chine et la Russie comme des concurrents stratégiques. Des changements ont eu lieu dans le paysage international. L'Europe ne devrait-elle pas chercher à maximiser leurs propres intérêts dans le nouveau contexte plutôt que de suivre l'ancien chemin? Les pays européens n'ont aucune raison de sacrifier leurs propres intérêts pour le nouveau fantasme de la guerre froide proposé par certaines élites américaines.
Le PCC a conduit la Chine à la prospérité. La Chine n'a pas pris part à une guerre depuis 30 ans et a insisté pour que la politique de défense nationale soit de nature défensive. C'est le plus grand partenaire commercial de plus de 100 pays et régions. Est-il possible de transformer un tel pays et son parti au pouvoir en "ennemi commun" du monde? Les élites américaines telles que Pompeo sont devenues hystériques à cause de leur paranoïa idéologique, c'est pourquoi elles continuent de viser la Chine de manière grossière et stupide. |
|
|